| Faites connaître cet article avec Google +1 |
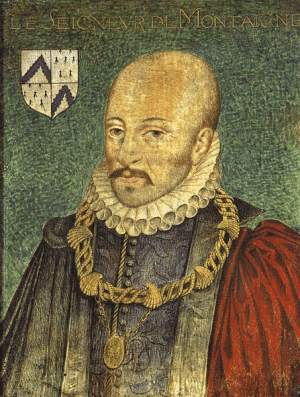
Note. Si l’on souhaite véritablement comprendre le scepticisme de Montaigne, il est préférable de connaître cette doctrine dont les racines sont déjà décelables chez certains présocratiques comme Xénophane (VI av. J.C.) ou, plus tardivement, chez l’atomiste Démocrite. Avant d’être une doctrine, le scepticisme est une attitude intellectuelle qui consiste à se demander si une véritable connaissance des choses est possible ou non. Opposé en cela au stoïcisme (Ecole philosophique fondée par Zénon de Cittium au début du III siècle av. J.C.), le scepticisme répond négativement à cette question. Ceci étant, penser que les choses sont inconnaissables ne dispense pas la raison d’agir et, de ce point de vue, l’œuvre de Montaigne (essentiellement : Les Essais), s’impose comme un chef d’œuvre. Cependant, et compte tenu de la filiation existant entre la pensée de Montaigne et celle des académiciens ou celle de Pyrrhon, je vous conseille vivement de lire au préalable les douze articles que j’ai consacrés, sur ce même site, au scepticisme. Ces articles retracent la lente évolution de la pensée sceptique depuis la fin du VI siècle avant J.C. jusqu’au texte, souvent hostile d’ailleurs, né à la fin du IV siècle apr. J.C sous la plume de Saint Augustin (Contre les académiciens.)
Avec Montaigne, nous quittons donc la fascinante période antique pour rejoindre les rives de la Renaissance. Natif du Périgord (en 1533), dès trois ans il apprend le latin grâce à l’érudition de son père. De là, sans doute, naquit son attirance pour les livres qui lui ouvrirent les portes de la culture classique. A vingt-quatre ans, il se lance dans une carrière politique à Bordeaux où il croise Etienne de la Boétie avec lequel il va partager une profonde amitié. L’auteur de la Servitude volontaire dévoilera la pensée stoïcienne à son ami mais mourra très jeune (à 33 ans) laissant Montaigne dans un profond désarroi. Tout comme la mort de Socrate influença très fortement la pensée platonicienne, il n’est pas imprudent d’imaginer que celle de La Boétie ne fut pas sans conséquences sur la rédaction des Essais. En effet, la peine, le chagrin renvoient inévitablement à soi-même et incitent à nous s’interroger sur la providence divine, notamment celle qui fut prônée par les stoïciens. C’est ainsi que, jusqu’à sa mort (en 1592), Montaigne n’aura de cesse de s’interroger sur lui-même mais non sans avoir mis, au préalable, son jugement à l’épreuve. Contrairement à Saint-Augustin, il ne règlera pas sa crise existentielle dans les eaux troubles de la religiosité. C’est pourquoi, et bien qu’il ne conteste nullement l’existence d’un dieu, tapi quelque part, il va feindre de plaider en faveur d’une religion fondée en raison tout en démontrant par ailleurs que l’homme à toutes les raisons de ne pas croire. Véritable tour de force qui donne parfois le vertige tant la confrontation du pour et du contre semble ne jamais avoir de fin.
Maintenant, une question se pose : Montaigne est-il un philosophe ou non ? Si l’on se réfère à Platon ou à Aristote (philosophes de « systèmes »), non ! Mais alors, comment expliquer l’immense retentissement de sa pensée dans la philosophie occidentale ? Un élément de réponse se présente à l’esprit : Montaigne s’adresse à l’homme. A partir de sa propre conscience, il interroge ce que l’on appelle : l’humanité. Car, la conscience de soi-même conduit à la conscience des autres. Elle est une passerelle entre « je pense donc je suis » et « tu penses donc tu es. » Ou, encore, entre « connais-toi toi-même » et « tu connaîtras les autres. » Montaigne est donc un homme qui parle à la fois à sa propre conscience et à celle des autres et qui, par-là même, offre le partage de sa propre intériorité. Précurseur de l’humanisme des lumières, Montaigne confronte la pensée à « l’humaine condition » c’est à dire à ses propres limites. Ici nous rejoignons le concept fondamental du scepticisme : que nous le voulions, ou non, la raison est à la fois prisonnière de son orgueil et de l’illusion de sa puissance. Voici le message essentiel que nous adresse Montaigne notamment dans le livre II des Essais : L’apologie de Raymond Sebond.
Livre des plus paradoxal, l’Apologie a été écrite afin de plaider en faveur d’un autre ouvrage rédigé, cette fois-ci, par le théologien espagnol Raymond Sebond. Intitulé : Théologie naturelle (texte qui fut traduit par Montaigne à la demande son père), ce livre tente de démontrer rationnellement la foi chrétienne et cela, essentiellement « par raisons humaines et naturelles. » Cependant, et abstraction faite de ce plaidoyer en faveur de Raymond Sebond. quel est le but recherché par l’Apologie ? Exposer la doctrine sceptique ? S’il ne s’agissait que de cela, les choses seraient fort simples et l’on pourrait, dès lors, établir un confortable parallélisme avec les Esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus. Cependant, apporter sa créance à Raymond Sebond expose à une redoutable contradiction : soit la raison est capable de tout connaître ce qui conduirait à penser que dieu est connaissable (nous serions ici dans un dogmatisme absolu) ou, à l’opposite, elle est limitée et faillible (thèse sceptique, par excellence) et, dès lors, la connaissance de dieu est impossible (la foi n’étant pas une connaissance.) Seulement, Montaigne n’est pas saint Augustin et ne peut donc se résoudre à épouser inconditionnellement le divin. Sans doute ceci explique-t-il son immense ambiguïté : « Le scepticisme de Montaigne, nous dit Carlos Lévy, (Les scepticismes, p. 99,) se caractérise par un certain nombre de tensions, qui ont fait qu’il a été tantôt interprété comme un sceptique dont la religion ne serait que superficielle, tantôt comme un authentique croyant mettant le doute systématique au service de sa foi. » Une nouvelle fois, nous sommes confrontés à l’une des caractéristiques les plus étranges de la pensée humaine. En effet, l’esprit est capable d’imaginer des entités hors de portée de sa perception et de la connaissance qu’il pourrait en avoir car, imaginer n’est pas connaître. Dès lors, si nous accordons notre assentiment aux objets issus de notre imagination, nous rejoignons le camp des dogmatiques ; si nous ne le donnons pas, nous nous retrouvons dans le camp adverse, celui des sceptiques. Montaigne semble se situer quelque part à mi-chemin entre ces deux attitudes. Serait-il pascalien ? « Nous avons une impuissance de prouver, invincible à tout le dogmatisme, nous dit Pascal (Pensées, p. 395), et nous avons une idée de la vérité, invincible à tout le pyrrhonisme (donc, le scepticisme.) » Bien sur, pour Pascal (comme pour Saint Augustin, d’ailleurs), la foi est la seule voie permettant de sortir de ce dilemme. Pour lui, l’homme est dual et ne peut donc qu’osciller entre des pôles contradictoires. Ceci étant, une unité se dégage de lui-même : la conscience de soi. Mais, chez Montaigne, de quel coté la balance penche-t-elle ? En d’autres termes, donne-t-il son assentiment à une présupposée unité « cosmique » scellant l’alliance entre dieu et les hommes ou persiste-t-il à douter ? Sans nuance aucune, Pascal nous fait part de son avis : « Car, s’il dit qu’il doute, il se trahit en assurant au moins qu’il doute : ce qui étant formellement contre son intention, il n’a pu s’expliquer que par interrogation ; de sorte que, ne voulant pas dire : « je ne sais », il dit : « Que sais-je ? » dont il fait sa devise, en la mettant sous des balances qui, pesant les contradictoires, se trouvent dans un parfait équilibre : c’est à dire qu’il est pur pyrrhonien. Oeuvres complètes, Ed. Lafuma, Seuil, p. 293. » Ici, Pascal nous dit clairement que Montaigne est un vrai sceptique tout en nous renvoyant à l’un des fondements du scepticisme : le doute. Et, de fait, le Montaigne sceptique est un Montaigne qui doute. Oui, mais de quoi ? En tout premier lieu : de la raison ! « Le moyen que je prends, nous dit-il (Ibid. p. 55), pour rabattre cette frénésie et qui me semble le plus propre, c’est de froisser et fouler au pied l’orgueil et humaine fierté ; leur faire sentir l’inanité, la vanité et misère de l’homme ; leur arracher des poings les chétives armes de leur raison ; leur faire baisser la tête et mordre la terre sous l’autorité et révérence de la majesté divine. C’est à elle seule, poursuit-il, qu’appartient la science et la conscience et la sagesse. » Des plus éclairants, ce passage dévoile le scepticisme de Montaigne envers le savoir. D’ailleurs, écoutons-le : « (...) De toutes les vanités, la plus vaine c’est l’homme ; que l’homme qui présume de son savoir, ne sait pas encore ce que c’est que savoir (Ibid. p. 56. » Donc, l’homme qui prétend qu’il sait ne sait même pas ce qu’est savoir. De même, l’homme qui prétend ignorer (tel Socrate) ne sait même pas ce qu’est ignorer car : « La véritable ignorance est celle qui s’ignore elle-même. (Ibid. p. 132.) » De fait, pour pouvoir affirmer que l’on ne sait rien, il faut préalablement avoir une idée de ce que ce cela veut dire donc ce qu’est le non-savoir. Cette obligation n’a pas échappé à l’Epicurien Lucrèce (I siècle av. J.C.) : « Certains penseurs estiment que toute science est impossible ; or ceux-là ignorent également si toute science est possible, puisqu’ils proclament ne rien savoir. (...) Et quand bien même j’accorderais à ces gens qu’assurément l’on ne sait rien, je leur demanderais comment, n’ayant jamais trouvé la vérité, ils savent ce qu’est savoir et ne pas savoir, d’où ils tirent la notion du vrai et du faux et par quelle méthode ils distinguent le certain de l’incertain. De la nature, p. 130. » Le procès intenté par Lucrèce contre le scepticisme est d’une redoutable pertinence car il montre l’impossibilité de discourir sans recourir aux affirmations qu’elles soient positives ou négatives. Finalement, la force des dogmatiques (Lucrèce appartient à ce courant de pensée) est de ne pas nier les évidences premières ; leur grande faiblesse est de vouloir justifier à tout prix (les critères des stoïciens, par exemple) la connaissance dispensée par ces mêmes évidences. En fait, la question soulevée ici concerne le « vrai. » Existe-t-il ? « Ainsi, nous dit Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhonienne, p. 53), pensent l’avoir trouvé ceux qu’on appelle dogmatiques, au sens propre, par exemple les partisans d’Aristote et d’Epicure, les stoïciens et quelques autres (...) »
Confronté à cette problématique, le scepticisme de Montaigne semble être un scepticisme empreint de pragmatisme et même « éclairé », pourrait-on dire. Cela pourrait expliquer, d’ailleurs, qu’il n’ait pu se résoudre à invalider totalement la foi. Cependant, est-ce aussi surprenant ? Peut-être pas. Surtout si l’on veut bien se souvenir qu’il incarne l’homme du questionnement perpétuel. Aussi, s’il ne tente pas de comprendre ce qu’est dieu (il ne peut être ni compris, ni connu) en revanche, il se demande pourquoi l’homme en a besoin. En d’autres termes : à quoi dieu sert-il ? Il est le pourvoyeur d’une vérité inaccessible à la seule raison, nous dit Montaigne : « Toutefois je juge ainsi, qu’à une chose si divine et si éminente, et surpassant de si loin l’humaine intelligence, comme est cette vérité de laquelle il a plu à la bonté de dieu de nous éclairer, il est bien besoin qu’il nous prête encore son secours. Apologie. p. 44. » Que pouvons-nous penser de cet extrait ? Tout d’abord, que l’intelligence humaine est bien misérable face à l’intelligence divine. Ensuite, que l’aide apportée aux hommes par dieu est également bien aléatoire puisqu’il faut qu’elle soit sans cesse renouvelée. Ici, Montaigne se situe entre Epicure et Saint Augustin. Si, pour l’un et pour l’autre, dieu existe, son rôle est bien différent. Pour Epicure : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde. Diogène Laërce : Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, Vol. II, p. 249. » Le fondateur de l’Ecole du « Jardin » vient de nous dire que l’homme reste nu face à lui-même et qu’il serait bien vain d’espérer une quelconque providence. A l’opposite, Saint Augustin associe dieu, la vérité et l’espérance. Ecoutons-le : « Vous êtes la vérité qui préside à toutes choses (...) C’est par l’espérance que nous avons été sauvés et nous attendons vos promesses patiemment. (Les Confessions, p. 248, 260.) » Epicure pense donc que l’on ne peut rien attendre du divin alors que Saint Augustin déclare exactement le contraire. Et, de son coté, Montaigne proclame l’existence d’une bienveillante intervention divine. Mais alors, comment expliquer la misère de l’homme en dépit de cette divine attention ? En effet, si l’homme vivait dans un monde sans dieu, sa misère pourrait s’expliquer puisque lui ferait défaut l’aide inestimable du « ciel ». Mais, si l’on veut bien entendre Montaigne, l’homme ne vit pas dans un monde sans dieu et pourtant, il semble faillir en tous domaines. C’est ici qu’achoppe la pensée de Montaigne et que son scepticisme s’avère des plus problématique. Paradoxalement, Montaigne est plus proche du stoïcisme que du scepticisme. Mais, si cela est, pourquoi l’Apologie de Raymond Sebond est-elle considérée comme le sommet du scepticisme de la Renaissance ? Le génie de Montaigne fut d’avoir radicalement dissocié la Cité céleste et la cité terrestre de Saint Augustin. Il a parfaitement compris que la seconde était totalement inaccessible à la raison. Alors, sans pour autant la nier, il s’en est intellectuellement détourné. De ce point de vue, un sceptique dirait qu’il a suspendu son jugement. Et c’est de cette attitude des plus pragmatique qu’a pu éclore son scepticisme. Maintenant, que reste-t-il de la Théologie naturelle de Raymond Sebond ? Un champ de ruines ! Car, nous dit Montaigne, il n’est pas possible de démontrer la foi, qu’elle soit chrétienne ou autre, « par raisons humaines et naturelles. » C’est au contraire, ajoute-t-il : « par l’entremise de notre ignorance plus que notre science que nous sommes savants de ce divin savoir. (Ibid. p. 129) » Lire une telle phrase tout en étant croyant doit être terrible. Car, que nous dit-elle ? Qu’il faut être ignare pour s’aventurer vers dieu...
La question de la transcendance étant réglée, restait à traiter celle de l’immanence. Comment les hommes vivent-ils ? Se demande alors Montaigne. A partir de cet instant, le doute sceptique va empreindre la plupart des aspects de l’humaine condition. Quasiment aucun n’y réchappera. En tout premier lieu, Montaigne critique sévèrement la thèse selon laquelle les hommes seraient supérieurs aux autres animaux : « Nous sommes le seul animal abandonné nu sur la terre nue, lié, garrotté, n’ayant de quoi s’armer et couvrir que de la dépouille d’autrui ; là où toutes les autres créatures, nature les a revêtues de coquille, de gousse, d’écorce, de poil, de laine (...) et les a elle-même (la nature) instruites à ce qui leur est propre, à nager, à courir, à voler, à chanter, là où l’homme ne sait ni cheminer, ni parler, ni manger, ni rien que pleurer sans apprentissage. Apologie. p. 66. » Empreint d’un indéniable scepticisme, cet avis n’est pas nouveau. Ecoutons Platon nous parler de l’une des versions du mythe de Prométhée (Protagoras 321c.) : « Cependant Epiméthée, qui n’était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait et lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage ; il voit les animaux bien pourvus, mais l’homme nu, sans chaussures (...) » Ce dénuement originel fut également relevé par Lucrèce (I siècle av. J.C.) : « L’enfant ressemble au matelot qu’ont rejeté des flots cruels, il gît à terre, nu, incapable de parole, dépourvu de tout ce qui aide à la vie, depuis le moment où la nature l’a jeté sur les rivages de la lumière, après l’avoir péniblement arraché au ventre de sa mère (...) Pendant ce temps croissent heureusement les troupeaux de gros et petit bétail et les animaux sauvages, qui n’ont besoin ni du jeu de hochet ni d’entendre le doux et chuchotant babil d’une tendre nourrice ; il ne leur faut point de vêtements qui changent avec les saisons, point d’armes pour protéger leurs biens, point de hauts remparts, puisque à tous fournissent toutes choses abondamment la terre féconde et l’industrieuse nature. De la nature. L. V. 221, 234. » Ces trois philosophes sont donc d’accord sur un point : parmi tous les animaux, l’homme est le plus fragile, le plus démuni et le plus vulnérable. Alors, s’interroge Montaigne, à quoi lui sert-il d’être à ce point présomptueux ? « La présomption, nous dit-il, est notre maladie naturelle et originelle. Apologie. p. 60. Il semble, insiste-t-il, à la vérité, que nature, pour la consolation de notre état misérable et chétif, ne nous ait donné en partage que la présomption. Ibid. p. 112. » Selon Montaigne, la présomption serait donc un masque destiné à compenser notre faiblesse. Faiblesse contre laquelle l’homme ne peut rien puisqu’elle caractérise l’humaine condition. Dès lors, « L’homme ne peut être que ce qu’il est, ni penser que selon sa portée. Ibid. p. 158. » Et surtout, pensa le stoïcien Epictète, l’homme doit savoir : « Qu’il y a des choses qui dépendent de lui (par conséquent, sur lesquelles il peut agir) ; il y en a d’autres qui n’en dépendent pas (vis à vis desquelles il est totalement impuissant.) Manuel. p. 183. »
Il faut donc, nous dit Montaigne, que l’homme soit lucide. Aucun crédit ne peut être porté à sa prétendue supériorité puisque, très souvent, même les animaux le surpassent : « Nous reconnaissons assez, en la plupart de leurs ouvrages, combien les animaux ont d’excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Ibid. p. 65. » Allant dans ce sens, de nombreuses anecdotes émaillent l’Apologie. Par exemple, le dévouement des chiens : « J’en ai vu, nous dit Montaigne, le long d’un fossé de ville, laisser un sentier plat et uni et en prendre un pire, pour éloigner son maître du fossé. Ibid. p. 77. » Un autre exemple (Ibid. p. 64) illustre l’étonnante organisation sociale des abeilles : « Au reste, qu’elle sorte de nos facultés ne reconnaissons-nous aux actions des animaux ? Est-il organisation réglée avec plus d’ordre, diversifiée à plus de charges et d’offices, et plus constamment entretenue que celle des abeilles ? » S’agit-il d’une vision anthropomorphique du monde animal ? On pourrait le penser. Le dévouement des chiens appartiendrait à l’éthique ; l’organisation sociale des abeilles ressortirait du politique et l’anecdote du gladiateur et du lion (Ibid. p. 96) s’attacherait à la mémoire donc, à l’histoire. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples car, pour Montaigne, il s’agit avant tout « de froisser et fouler aux pieds l’orgueil et humaine fierté. » Mais, ce faisant, il va à l’encontre d’un célèbre verset biblique selon lequel dieu aurait créé l’homme à son image. Si les animaux sont véritablement supérieurs à l’homme, dieu et ce même homme seraient donc inférieurs et, par voie de conséquence, imparfaits. Il serait possible de s’accommoder de cela mais, parmi les attributs que Montaigne prête à dieu, il en est un, essentiel, qui n’est pas partagé par l’homme ou les autres animaux : l’intemporalité donc, l’immortalité. A ce propos, écoutons Montaigne : « Par quoi il faut conclure que dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps, ni sujette à aucune déclinaison ; devant lequel rien n’est, ni ne sera après, ni plus nouveau ou plus récent, mais un réellement étant, qui, par un seul maintenant emplit le toujours (...) Ibid. p. 279. » Confronté à cette redoutable contradiction, Montaigne aurait-il penché vers « l’hérésie » comme le firent, en matière de science et à juste titre, Copernic ou Galilée ? Fut-il, en matière de philosophie, l’initiateur d’une réplique de la révolution copernicienne ? Révolution qui effaça la thèse géocentrique chère à Aristote, à Ptolémée et aux pères de l’église chrétienne au profit de la thèse héliocentrique reprise, plus tard, par Galilée. Quoiqu’il en soit, Copernic infligea la première et profonde blessure à l’égocentrisme de l’homme (Freud) et, de son coté, Montaigne réduisit l’illusion de sa puissance à quasiment rien. Dès lors, l’homme ne fut plus au centre du monde et ne fut même plus au sommet de son propre petit monde.
Abordant ici les rives d’un scepticisme plus « technique », Montaigne soulève une question maintes fois évoquée : les sens sont-ils fiables ? En d’autres termes, la raison peut-elle se fier à ce qu’ils perçoivent ? Les stoïciens et les épicuriens avaient répondu par l’affirmative alors que les sceptiques (notamment les académiciens, les pyrrhoniens et Sextus Empiricus) s’étaient inscrits en faux contre cet avis. Et Montaigne ? Véritable casse tête pour les exégètes, une phrase de l’Apologie atteste le relativisme de sa pensée : « Les sens sont le commencement et la fin de l’humaine connaissance. Ibid. p. 256. » Comment interpréter un tel avis ? En tout premier lieu, les sens ne sont pas niés puisqu’ils sont le commencement de « l’humaine connaissance. » Mais, en second lieu, ils ne semblent pas conduire très loin puisqu’ils sont également la fin de cette même « humaine connaissance. » Montaigne pense-t-il donc que les sens et l’humaine connaissance seraient une seule et même chose ? Ou, s’inscrit-il en faux contre le sentiment de Lucrèce pour lequel : « Tu verras que les sens sont les premiers à nous avoir donné la notion du vrai et qu’ils ne peuvent être convaincus d’erreur. Car le plus haut degré de confiance doit aller à ce qui a le pouvoir de faire triompher le vrai du faux. Or quel témoignage a plus de valeur que celui des sens ? (...) J’en conclus que leurs témoignages en tout temps sont vrais. Ibid. p. 130, 131. » Lucrèce n’évoque ni commencement ni fin. Il se contente de nous dire que, en soi, les sens sont fiables et que, par conséquent, nous pouvons donner notre assentiment à ce qu’ils nous disent. Face à cet avis pour le moins catégorique, l’opinion de Montaigne est bien moins affirmée. En effet, si les sens sont la fin de l’humaine connaissance, ils sont également le début de l’humaine ignorance ce qui ne peut que conduire à la question centrale de son oeuvre : « Que sais-je ? » D’une étonnante subtilité, cette question conduit à l’évitement de l’affirmation Socratique : « Je sais que je ne sais rien ! » De plus, elle permet de ne pas exprimer le doute implicite qu’elle suggère car, comme le remarqua Pascal (Cf. Supra) : « S’il dit qu’il doute, il se trahit en assurant au moins qu’il doute : ce qui est formellement contre son intention (...) » Donc, Montaigne doute mais ne l’affirme pas.
Ceci étant, force est de constater que l’homme est pourvu de sens qui l’informent en permanence sur son environnement. Et, de ce point de vue, même un sceptique ne peut nier leur existence. Alors, sur quoi va porter le débat ? Si nous adoptons la logique de Montaigne, une question vient immédiatement à l’esprit : A quoi servent-ils ? Ou, comme dirait un moderne : Qu’elles sont leurs performances ? Prenant pour exemple une pomme, Sextus Empiricus (Ibid. p. 109) remarque que : « Il est donc possible que nous, n’ayant que cinq sens, ne saisissions parmi les qualités de la pomme que celles qui sont saisissables par nous (...) Or, si les sens ne saisissent pas les objets extérieurs (dans leur totalité, pense Sextus), la pensée n’est pas non plus capable de les saisir, de sorte que du fait de cet argument lui aussi, nous sommes d’avis de suspendre notre assentiment à propos des choses extérieures. » D’une extraordinaire lucidité, cet avis nous explique pourquoi les sens ne sont, en aucun cas, parfaitement fiables. Pour qu’elle raison ? Tout simplement, vient de nous dire Sextus, parce qu’ils ne peuvent que saisir la réalité partielle des choses et non la réalité totale de ces mêmes choses. Or, si le réel est, il est en totalité et, s’il n’est que partiel, il n’est pas car, le diviser, revient à ne pas le connaître entièrement. Par conséquent, et contrairement à ce que pensaient les stoïciens et les épicuriens, les sens ne peuvent être des critères d’un vrai entendu, évidemment, comme l’expression absolue de la réalité.
Réplique lointaine de la pensée de Sextus, Montaigne reviendra sur l’exemple de la pomme : « Nous saisissons la pomme quasi par tous nos sens ; nous y trouvons de la rougeur, de la polissure, de l’odeur et de la douceur ; outre cela, elle peut avoir d’autres vertus, comme d’assécher ou de restreindre, auxquelles nous n’avons point de sens qui se puissent rapporter. » Toutefois, le procès intenté aux sens par Sextus et Montaigne ne s’arrête pas à leur nombre. L’un et l’autre se réfèrent, sans le citer, d’ailleurs, au relativisme du sophiste Protagoras. A ce sujet, écoutons Sextus (Ibid. p. 145) : « Ils sont, en effet (les sens), relatifs à ceux qui les perçoivent (...) » Et, que nous dit Montaigne ? Que « Notre état accommodant les choses à soi et les transformant selon soi, nous ne savons plus quelles sont les choses en vérité ; car rien ne vient à nous que falsifié et altéré par nos sens. Ibid. p. 273. » Ici, la référence au huitième trope d’Enésidème (Cf. L’un de mes précédents articles : Le scepticisme des successeurs de Pyrrhon) ne peut être plus claire. Rappelons-le : « Tout est relatif par rapport à ce qui juge et par rapport à ce qui est observé. » Que cela veut-il dire ? Tout simplement qu’il existe une interaction entre la chose observée et celui qui l’observe. Dès lors, il devient évident que la connaissance véritable des choses ne peut provenir des sens. Mais alors, peut-on s’en remettre à la raison ? Pour le moins, Montaigne semble en douter. S’appuyant, sans le nommer, sur le deuxième trope d’Agrippa (Sextus Empiricus. Ibid. p. 241), voici ce que Montaigne nous dit : « Pour juger des apparences que nous recevons des choses, il nous faudrait un instrument judicatoire (qui permette de juger) ; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voila dans un cercle vicieux. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison ; (or) aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusque à l’infini. (Ibid. p. 274, 275.) » Si l’on considère que la causalité est une donnée irréductible à l’esprit, Montaigne a forcément raison. Car, si un effet a besoin d’une cause, cette même cause a besoin d’une autre cause et ainsi de suite, jusqu’à l’infini. Toutefois, l’esprit s’épuiserait en vain en tentant de suivre cette route d’où, d’ailleurs, le sens profond de la suspension du jugement si chère aux sceptiques. Si, comme le pense Montaigne, l’esprit est à ce point limité, la sagesse la plus élémentaire consiste à en tenir compte et à savoir déceler le moment précis où commencent nos propres limites.
Pour Montaigne, ces limites commencent par l’incapacité de l’homme à se connaître lui-même. Considéré sous cet angle, la notion de limite apparaît être totalement liée à l’humaine condition. Et, conséquemment, si l’homme ne peut se connaître lui-même, par quel tour de force pourrait-il connaître ce qui l’entoure ? La première victime de cet avis est le fondateur du relativisme primitif : Protagoras. En effet, et après avoir déclaré que « l’homme n’est non plus instruit de la connaissance de soi en la partie corporelle qu’en la spirituelle (Ibid. p. 212) », Montaigne cite Pline qui nous dit ceci : « Comme si l’on pouvait prendre la mesure de quoi que ce soit, quand on ignore sa propre mesure. » Poursuivant, Montaigne ajoute que : « vraiment Protagoras nous en contait de belles, faisant (de) l’homme la mesure de toutes choses, qui ne sut (connut) jamais seulement la sienne. (Ibid. p. 213.) » Le procès est clair : dans la mesure ou Protagoras ne dispose pas de sa propre mesure, comment peut-il affirmer « qu’il est la mesure de toutes choses ? » Quelques lignes plus loin, Montaigne se réfère au présocratique Thalès : « Quant Thalès estime la connaissance de l’homme très difficile à l’homme, il lui apprend la connaissance de toute autre chose lui être impossible. » Il ressort de tout ceci que le sujet connaissant ne peut connaître qu’à la condition sine qua non de se connaître lui-même. Ne retrouvons-nous pas ici le « Connais-toi toi-même » de Socrate ? Ceci étant, Protagoras eut-il vraiment tord ? Après tout, lorsqu’il nous dit que « l’homme est la mesure de toutes choses », il ne nous parle que de l’homme et non d’autre chose. Et qui pourrait nier que cet homme dispose de ce que l’on appelle la conscience de soi ? Alors, cette conscience de soi ne serait-elle pas sa propre mesure ? Seulement, si l’on adopte ce point de vue, une question vient à l’esprit : si l’homme est sa propre mesure, quelque part, il est sa propre cause. Et, dès lors, à quoi pourrait bien servir dieu ? D’ailleurs, à quoi sert-il ? A expliquer notre origine ? A nous rassurer ? A justifier notre mort ? Ici, non ! Du moins si l’on en croit la légende chrétienne. Car, selon cette même légende, qui est responsable de la mort de l’homme sinon lui-même ? Cependant, et au risque de frôler le sophisme, admettre l’existence du péché originel reviendrait à conforter la thèse de Protagoras puisque ce serait donc l’homme qui serait la cause, et donc la mesure, de sa propre mort ! Cette question est vertigineuse car elle en soulève une autre qui concerne, cette fois-ci, la « toute puissance » divine. Si l’on suit les textes dits « sacrés », dieu est la puissance même ; il est la cause des causes ; le destin des destins, pourrait nous dire un stoïcien qui ne serait pas un panthéiste. Il est donc l’explication de tout, « la surnaturelle et divine science », nous dit Montaigne. Voici là, une terrible contradiction car, si dieu est véritablement la cause des causes, il est également la cause directe de la misère humaine !
Si dieu est donc « la surnaturelle et divine science », on est en droit de se demander à quoi peut bien servir cette divine science. En effet, si la raison humaine est misérable, limitée, que dire de la raison divine dont l’omnipotence est à ce point inopérante et, par conséquent, parfaitement inutile. Ici encore, nous nous heurtons à l’ambiguïté de Montaigne qui, et fort sagement d’ailleurs, ne se risque pas à émettre un jugement de valeur au sujet des conduites divines. Mais, qui le pourrait ? Même un Saint Augustin ne s’y est pas risqué. Finalement, l’avis le plus éclairé est sans doute celui d’Epicure : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde. » (Cf. supra) Conséquemment, l’homme est seul. Il est face à lui-même. Il ne peut espérer aucun secours venu du « ciel » ou d’ailleurs. Si Montaigne avait écrit cela, son scepticisme serait d’une toute autre ampleur. Par contre, il a intenté de redoutables procès aux superstitions, croyances et même aux inhumaines cruautés imputables aux religions. A titre d’exemple, écoutons-le nous parler de la réincarnation : « Bien plus, que si les âmes venaient d’ailleurs que d’une suite naturelle, et qu’elles eussent été quelque autre chose hors du corps, elles auraient le souvenir de leur être premier, attendu les naturelles facultés qui lui sont propres de penser, raisonner et se souvenir. » (Ibid. p. 199.) Cependant, Montaigne ne fut pas le premier à s’insurger contre cette croyance absurde. Lucrèce, déjà, s’était penché sur cette question : « Si l’âme est immortelle et qu’au moment de la naissance elle se glisse dans le corps, pourquoi notre vie antérieure ne nous laisse-t-elle aucun souvenir ? Pourquoi ne conservons-nous aucune trace de nos anciennes actions ? (...) Allons ! l’âme d’autrefois est morte et celle d’aujourd’hui a été créée aujourd’hui. » (Ibid. Vol. III. p. 103.) Un petit peu plus loin (page 108), Lucrèce revient sur le sujet : « Et quant bien même le temps, après notre mort, rassemblerait toute notre matière et la réorganiserait dans son ordre actuel en nous donnant une seconde fois la lumière de la vie, là encore il n’y aurait rien qui nous pût toucher du moment que rupture se rait faite dans la chaîne de notre mémoire. » Inutile d’être féru de scepticisme pour suivre ces deux philosophes dont les paroles sont frappées à l’aune du simple bon sens ! Et pourtant, notamment depuis Pythagore, combien d’hommes considèrent, et aujourd’hui encore, cette fable conforme à la réalité ! Décidément, pauvre naïveté humaine...
Il en va de même, nous dit Montaigne, des délirantes espérances promulguées par les farceurs des religions : « Quand Mahomet, remarque-t-il, promet au sien un paradis tapissé, paré d’or et de pierreries, peuplé de jeunes filles d’excellente beauté, de vins et de mets rares, je vois bien que c’est un moqueur qui se plie à notre bêtise pour nous emmieller et attirer par ces opinions et espérances convenables à notre mortel appétit. (Ibid. p. 154.) » Evoquant cette fois-ci les chrétiens, Montaigne poursuit : « Pourtant, sont aucuns des nôtres (il existe des chrétiens) tombés en pareille erreur, se promettant après la résurrection une vie terrestre et temporelle, accompagnée de toutes sortes de plaisirs et commodités mondaines (...) » Quelque part, Montaigne pense que l’humaine condition est associée à « l’humaine naïveté. » Car, s’il en était autrement, comment l’homme pourrait-il imaginer une vie dans l’au-delà aussi mirifique et, paradoxalement, aussi semblable à celle qu’il perdra ? Par conséquent, si Montaigne ne renie pas la transcendance, il prend grand soin de la distinguer des réalités terrestres : « Nous ne pouvons dignement concevoir la grandeur de ces hautes et divines promesses, si nous les pouvons aucunement concevoir ; pour dignement les imaginer, il faut les imaginer inimaginables, indicibles et incompréhensibles, et parfaitement autres que celles de notre misérable expérience. (Ibid. p. 155) » En parfait accord avec lui-même, Montaigne vient de nous dire que la raison, ainsi que l’imagination, ne peuvent en aucun cas se représenter dieu et que : « c’est la foi seule qui embrasse vivement et certainement les hauts mystères de notre religion (le catholicisme.) » Finalement, la foi est hors de tout. Elle ne peut être justifiée que par l’expérience mystique qui, elle-même, se dérobe à tout argument. C’est bien pourquoi, d’ailleurs, qu’un croyant ne pourra jamais convaincre un athée, ou un agnostique, et inversement. Acte est donc pris de la puissance inintelligible de la foi. Cependant, Montaigne ne se limite pas à cet avis. C’est ainsi qu’il nous adresse cette saisissante remarque (Apologie. p. 152) : « Les choses les plus ignorées sont les plus propres à être déifiées. Par quoi de faire de nous des dieux, comme l’Antiquité, cela surpasse l’extrême faiblesse du comble de la naïveté. » De fait, si d’un coté l’homme croit en l’existence d’un dieu, ou de plusieurs dieux, et que, de l’autre, il est incapable de se le représenter, que peut-il faire d’autre que de l’imaginer à son image ? C’est ainsi qu’après avoir expliqué que les animaux ne prisent rien au-dessus de leur espèce, Montaigne s’arrête un instant sur cet anthropomorphisme : « D’où naissent ces anciennes conclusions : De toutes les formes, la plus belle est celle de l’homme ; dieu donc est de cette forme (...) dieu est donc revêtu de l’humaine figure (...) C’est pourquoi, disait plaisamment Xénophane (Frag. 15), que si les animaux se forgent des dieux, comme il est vraisemblable qu’ils fassent, ils les forgent certainement à leur image et se glorifient comme nous. (Ibid. p.175, 176.) » Si l’on veut bien suivre Montaigne, et Xénophane, s’il est pour le moins douteux que dieu ait créé l’homme à sa propre image par contre, il l’est beaucoup moins que l’homme ait créé dieu à sa propre image...
Pour Montaigne, donc, les animaux sont souvent supérieurs à l’homme ; l’humaine raison est limitée, misérable ; les sens sont peu fiables et trompeurs ; dieu est inconnaissable et cela, que ce soit au niveau de son concept ou de son image. Alors, se demande Montaigne, qu’en est-il du fait religieux ? Certes, nous dit-il, la foi repose sur la faiblesse de la raison, l’ignorance, précise-t-il. Cependant, lui-même ne renonce pas à penser. Et, de ce point de vue, n’annonce-t-il pas le rationalisme classique d’un Descartes ou d’un Spinoza pour lesquels la raison est autonome et la foi uniquement consacrée au salut de l’âme ? Loin d’être étrange, cette bipartition facilita le sauvetage de la foi en circonscrivant son domaine propre. Mais, remarquons également qu’elle a favorisé durant le « siècle des lumières » l’émergence d’un athéisme philosophique lequel reposa sur une explication matérialiste du monde (après celle des atomistes et des épicuriens, il est vrai.) Ceci étant, Montaigne ne fut pas le fondateur de cette opposition entre raison et foi. En effet, et bien auparavant, ce fut l’épicurien Lucrèce qui affirma l’impuissance divine et donc son absolue inutilité : « Le principe qui nous servira de point de départ, c’est que rien ne peut être engendré de rien par l’effet d’une puissance divine. (...) Pour moi, quand j’ignorerais la nature des éléments premiers, j’oserais encore, sur le simple examen des phénomènes du ciel et sur bien d’autres faits, affirmer que l’univers n’a pas été fait pour nous de création divine, tant l’ouvrage est défectueux ! (Ibid. p. 22, 57.) » La filiation avec Epicure ne peut être plus claire mais se poursuit-elle avec Montaigne ? Non ! Et, pourquoi ? Parce qu’Epicure et Lucrèce sont des polythéistes dont les dieux ne peuvent donc constituer une cause unique alors que Montaigne et un monothéiste. Pour lui, un seul dieu et, par conséquent, une seule volonté. Ainsi, et puisque les actions de la raison se limitent à son propre entourage, il faut s’en contenter, semble penser Montaigne. C’est pourquoi, et sans aucun scrupule, il relativise la nature même du fait religieux. Ecoutons-le : « Nous ne recevons notre religion qu’à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés au pays où elle était en usage ; ou nous regardons son ancienneté ou l’autorité des hommes qui l’ont maintenue ; ou craignons les menaces qu’elle attache aux mécréants ; ou suivons ses promesses. (...) Nous sommes Chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands. (Ibid. p. 50, 51.) » Finalement, Montaigne vient de nous dire que la religion n’est aucunement fondée sur une quelconque révélation mais bien davantage sur une culture. Et cela explique sans doute l’une de ses caractéristiques essentielles : mêler l’universalité et la diversité. Aussi, et bien qu’il existe de multiples formes de religions, un dénominateur commun les réunit : le fait religieux en soi. Considéré sous cet angle, et c’est ce que semble suggérer Montaigne, la religiosité résulterait d’un besoin visant à solder les comptes d’une raison fort dépourvue sur bien des sujets : « Tous les autres phénomènes que les mortels voient s’accomplir sur terre et dans le ciel tiennent leurs esprits suspendus d’effroi, les livrent humiliés à la terreur des dieux, les courbent, les écrasent contre terre : c’est que l’ignorance des causes les oblige à abandonner toutes choses à l’autorité divine, reine du monde ; et tout ce que leur dérobe ces causes, ils le mettent au compte d’une puissance surnaturelle. (Lucrèce. Ibid. p. 200.) »
Cependant, si la religion se contentait de compenser le vide inhérent à la faiblesse humaine, on pourrait facilement s’en accommoder. Seulement, nous dit Montaigne, la religion génère barbarie et cruauté. Ecoutons le d’ailleurs évoquer César (Guerre des Gaules, VI, XVI) : « Alexandre, arrivé à l’Océan Indique, jeta en mer, en faveur de Thétis (déesse marine aux pieds d’argent), plusieurs grands vases d’or ; remplissant en outre ses autels d’une boucherie non de bêtes innocentes seulement, mais d’hommes aussi, ainsi que plusieurs nations, et entre autres la nôtre, avaient en usage ordinaire. Et crois qu’il n’en est aucune exempte d’en avoir fait ainsi. (Ibid. p. 159.) » A la suite de cette évocation, Montaigne cite de nouveaux exemples montrant combien la religion aime le sang : « S’il vient (le sacrifié) à s’enferrer en lieu mortel et qu’il trépasse soudain, ce leur est un signe certain de faveur divine ; s’il en échappe, ils l’estiment méchant et exécrable, et en députent (choisissent) encore un autre de même. Amestris, mère de Xerxès, devenue vieille, fit en une seule fois ensevelir tout vifs quatorze jouvenceaux des meilleures maisons de Perse, suivant la religion du pays. (...) Encore aujourd’hui, les idoles de Themistitan se cimentent du sang des petits enfants, et n’aiment sacrifice que de ces puériles et pures âmes : justice affamée du sang de l’innocence. (Tant la religion, avait dit Lucrèce, a pu inspirer de crimes !) » Toujours dans le même passage, Montaigne poursuit : « Les Carthaginois immolaient leurs propres enfants à Saturne ; et qui n’en avait point, en achetait (...) C’était une étrange idée de vouloir payer la bonté divine de notre affliction, comme les Lacédémoniens qui flattaient leur Diane par la torture des jeunes garçons (...) » De fait, nous dit Montaigne, qu’elle que soit la religion et les rites qui l’accompagnent, la finalité est toujours la même : la mort ! Cependant, remarque-t-il, il pourrait en être tout autrement : « Ce qu’on nous dit de ceux du Brésil, qu’ils ne mouraient que de vieillesse, et qu’on attribue à la sérénité et tranquillité de leur air, je l’attribue plutôt à la tranquillité et sérénité de leur âme, déchargée de toute passion et pensée et occupation tendue ou déplaisante, comme gens qui passaient leur vie en une admirable simplicité et ignorance, sans lettres, sans loi, sans roi, sans religion quelconque. (Ibid. p. 116, 117.) »
Au sortir d’un tel procès intenté contre le fait religieux, on pourrait se demander pourquoi Montaigne ne va pas jusqu’à invalider la foi. Après tout, puisque la foi fonde les religions et que celles-ci sont à ce point nocives, ne vaudrait-il pas mieux la combattre ? Mais, souvenons-nous que « l’opium du peuple » à la vie dure et que le fidéisme de l’Apologie permet à Montaigne de bien différencier le connaissable de l’inconnaissable, le « terrestre » du « céleste. » Et, plus important encore, remarquons que la foi est une passerelle entre ces deux mondes. Confronté à ce dualisme (finalement, tout à fait platonicien) le scepticisme de Montaigne ne peut donc concerner que ce qui est compréhensible, observable et, par conséquent, analysable. Alors que les religions reposent sur un charlatanisme quasi universel ; qu’elles génèrent barbarie et cruauté ; qu’elles humilient la raison sont autant de faits susceptibles d’être soumis à un examen rigoureux. Ce questionnement, cette enquête, devrait-on plutôt dire, sont à la base de l’Apologie et, plus largement, à celle des Essais. Dans cette oeuvre, Montaigne apparaît être bien plus un magistrat qu’un philosophe. Pour lui, chaque sujet abordé est un dossier au sujet duquel avis doit être donné et cela, au terme d’une confrontation entre le pour et le contre. Façonné à l’aune de cette logique contradictoire, Montaigne ne pouvait plaider pour un avis dogmatique comme, d’ailleurs, suspendre totalement son jugement. Sa grande force est d’avoir su qu’il évoluait dans l’aléatoire et non dans le certain. C’est pourquoi son écriture est diverse, éclatée, fluctuante, parfois, mais jamais non fondée. Elle est à l’image de l’être humain qui est, lui-même, à chaque instant donc autant de fois lui-même qu’il y a d’instants.
Un tel relativisme repose certainement sur l’expérience juridique de Montaigne. Rappelons, en effet, la fonction de conseiller qui lui fut attribuée à la chambre des enquêtes du parlement de Bordeaux. En ce lieu, il faut étudier, décortiquer des dossiers plus ou moins complexes. Il faut interpréter, réinterpréter des données qui s’inscrivent dans un rapport de forces résultant des intérêts contradictoires des parties concernées. Alors, dans ce contexte, les opinions prévalent et la vérité, s’il existe une vérité, dépend du talent des hommes de loi. Montaigne connaît parfaitement ce monde soumis aux caprices de la subjectivité. D’ailleurs, écoutons-le : « Les avocats et les juges de notre temps trouvent à toutes causes assez de biais pour les accommoder où bon leur semble. A une science si infinie, dépendant de l’autorité de tant d’opinions et d’un sujet si arbitraire, il ne peut se faire qu’il n’en naisse une confusion extrême de jugements. Aussi n’est-il guère si clair procès auquel les avis ne se trouvent divers. Ce qu’une compagnie a jugé, l’autre le juge en un sens contraire, et elle-même au contraire une autre fois. Ibid. p. 249. » On ne peut affirmer que Montaigne pensait à Protagoras ou à Arcélisas lorsqu’il écrivit ces lignes. Toutefois, elles épousent parfaitement l’avis de ces deux philosophes : Il est possible d’opposer à tout discours un autre de force égale exprimant exactement le contraire. Si donc, en matière de justice, il n’est pas possible de formuler un avis universel il en va de même, pense Montaigne, en matière de philosophie. Et, de ce point de vue, accordons-lui qu’il est très difficile de le contredire. Voici, par exemple, les divergences qu’il relève chez Platon, Epicure et chez quelques-uns des présocratiques : « Je ne sais pas pourquoi je n’acceptasse autant volontiers ou les idées de Platon, ou les atomes d’Epicure, ou le plein et le vide de Leucippe et Démocrite, ou l’eau de Thalès, ou l’infini de nature d’Anaximandre (...) ou les nombres et symétrie de Pythagore, ou l’infini de Parménide (...) ou la discorde et l’amitié d’Empédocle, ou le feu d’Héraclite, ou toute autre opinion de cette confusion infinie d’avis et de propositions que produit cette belle raison humaine par sa certitude et clairvoyance en tout ce de quoi elle se mêle (...) Ibid. p. 186, 187. » Abstraction faite de l’ironie qui transparaît dans cette citation, Montaigne constate, à juste titre, qu’il existe presque autant de doctrine que de philosophes. Finalement, la connaissance, (ou son impossibilité), est mise à rude épreuve. D’ailleurs, il ne s’en cache pas : « Si ce que nous n’avons pas vu n’est pas, notre science est merveilleusement raccourcie. Ibid. p. 60. » Quelques pages plus loin (110 et 111), il met en doute les vertus de la science en matière de bonheur humain : « A-t-on trouvé que la volupté et la santé soient plus savoureuses à celui qui sait l’astronomie et la Grammaire ? (...) J’ai vu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l’université, et auxquels j’aimerais mieux ressembler. » Ici, apparaît une distinction fondamentale entre le « pensé » et le « vécu » et, effectivement, si pour penser il faut vivre, penser et vivre n’est pas forcément la même chose. Aussi, bien que l’un ne complète pas forcément l’autre, il ne l’annule pas pour autant. Finalement, face à celle des stoïciens ou des épicuriens, par exemple, la philosophie de Montaigne apparaît être bien plus désespérée. En effet, que ce soit pour le portique (le stoïcisme) ou pour le jardin (l’épicurisme), philosopher devait conduire à l’ataraxie ou, en d’autres termes, a une certaine forme de bonheur. Nous ne retrouvons pas cet espoir chez Montaigne qui nous parle d’un homme dénué de tout. Colosse aux pieds d’argile, son humaine raison ne peut enrayer les outrances de son humaine condition alors que, nous dit Montaigne, « Si l’homme était sage, il prendrait le vrai prix de chaque chose selon qu’elle serait la plus utile et propre à sa vie. Et, qui nous évaluera par nos actions et notre conduite, il s’en trouvera plus grand nombre d’excellents entre les ignorants qu’entre les savants. (Ibid. p. 111.) » Ici, Montaigne privilégie nettement l’approche éthique au détriment de la raison. En effet, pense-t-il, par rapport à la connaissance, l’ignorance favorise davantage l’excellence. Curieux paradoxe venant d’un homme qui, non seulement rédigea une oeuvre prodigieuse mais qui, de surcroît, se dota d’une immense culture.
D’évidence, Montaigne a lu les fragments 10 et 117 de Démocrite selon lesquels « Nous ne saisissons pas véritablement ce que chaque chose est ou n’est pas (...) En réalité nous ne savons rien, car la vérité est au fond de l’abîme. » De même, sa conception selon laquelle tout est mouvant, tout n’est que diversité, s’appuie sur le célèbre fragment 31 d’Héraclite : « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. » Grâce à Diogène Laërce, il sait que Protagoras « fut le premier qui déclara que sur toute chose on pouvait faire deux discours exactement contraire, et il usa de cette méthode, » comme il n’ignore pas que « La philosophie de Pyrrhon introduit l’idée qu’on ne peut connaître aucune vérité, et qu’il faut suspendre son jugement (...) Il soutenait qu’il n’y avait ni beau, ni laid, ni juste, ni injuste, que rien n’existe réellement et d’une façon vraie, mais qu’en toute chose les hommes se gouvernent selon la coutume et la loi. Car une chose n’est pas plutôt ceci que cela. » Le scepticisme de Montaigne est profondément ancré dans l’histoire de la philosophie. Si, et selon son propre aveu, « il a seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n’y ayant fourni du sien que le filet à les lier, » il a oublié de nous dire qu’il a du, auparavant, les couper. Et c’est ce qu’il fit avec un indéniable talent. La diversité des avis, celle des sens, celle des hommes, interdit donc d’imaginer un critère global susceptible de la recouvrir et de la définir d’une manière univoque. Par exemple, évoquant la beauté féminine, Montaigne nous dit que : « Les Indiens la peignent noire et basanée, aux lèvres grosses et enflées, au nez plat et large (...) Au Pérou, les plus grandes oreilles sont les plus belles (...) Chez les Basques, les femmes se trouvent plus belles la tête rase (...) Les Mexicaines comptent entre les beautés la petitesse du front (...) Les Italiens la façonnent grosse et massive (...) Les Espagnols la préfèrent sèche et étrillées (...) » (Ibid. p. 104, 105.) Montaigne vient donc de constater l’existence d’un indéniable relativisme en matière de beauté féminine ce qui nous renvoie à un relativisme de même nature en matière de culture. Ce qui serait donc vrai pour l’homme, entendu comme individu, le serait également pour des communautés d’hommes. Ceci explique, d’ailleurs, les innombrables conflits qui, de tout temps, sèment la dévastation au sein de notre petite planète. Ici, s’exprime avec force l’humanisme de Montaigne. Selon sa pensée, l’expérience de la vie, celle des autres, n’est pas unique mais s’appuie sur sa propre diversité. C’est bien parce que les autres sont précisément « autres » que « penser l’homme » revient à « penser les hommes. » Sans pour autant les renier, Montaigne a su s’affranchir du monde abstrait des idées pour faire abstraction de lui-même afin de se poser une question devenue célèbre beaucoup tard : « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »
Patrick Perrin


