| Faites connaître cet article avec Google +1 |
LA RECHERCHE DU BONHEUR OU L’ATARAXIE DANS LA PHILOSOPHIE ANTIQUE SAGESSE OU UTOPIE ?
« Je suis bien marri que nous n’ayons une douzaine de Laertius (Diogène Laërce – entre 200 et 500 après J.C. -), ou qu’il ne soit plus étendu ou plus entendu, car je suis pareillement curieux de connaître les fortunes et la vie de ces grands précepteurs du monde, comme de connaître la diversité de leurs dogmes et fantaisies » (Montaigne : Essais II, 10)
INTRODUCTION
Lors de la rédaction de mon précédent article : Grandeur et décadence du logos dans la philosophie antique (Ce texte que je conseille vivement de lire ou relire est en ligne sur ce même site), j’ai essayé de montrer comment la raison s’était émancipé du carcan mythologique qui l’étouffait. En s’écartant progressivement du muthos (que l’on peut traduire par : “parole mythique”), le logos (ou parole philosophique) a accompagné ce long cheminement jusqu’à ce que la chrétienté, et avant même qu’elle ne soit politiquement triomphante, se soit emparée de ce concept pour l’asservir à son idéologie. Dès lors, le logos cessa de traduire la pensée philosophique et devint un outil docile dans les mains des manipulateurs religieux. Et, comme beaucoup d’athées (négation de l’existence de dieu), je ne suis pas très sur que notre civilisation soit sortie renforcée de ce véritable détournement.
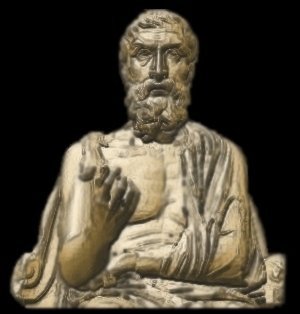
Épicure
Dans ce nouvel article nous allons nous pencher sur une deuxième notion essentielle qui caractérisa la philosophie antique : l’ataraxie. Il ne faut pas redouter l’apparente connotation absconse (hermétique) de ce terme qui, en fait, ne désigne que la recherche d’un bonheur reposant sur “l’absence de troubles” ou, encore, sur la “quiétude de l’âme”. Et, soulignons-le, cette quête incessante du bonheur concerne la quasi-totalité des hommes et donc, la philosophie considérée, toutefois, sous son angle éthique. (Ne pas confondre cette notion qui concerne les conduites et comportements humains avec la morale qui, elle, édicte les devoirs assignés à l’homme.). Ceci étant, pour nous, modernes, comment illustrer l’ataraxie recherchée par certains philosophes de la période antique ? Prenons pour exemple un homme modeste dont les revenus ne lui permettent qu’à peine de vivre. Néanmoins, il possède une petite voiture tout à fait en accord avec sa condition sociale. Imaginons maintenant qu’il “rêve” de posséder une voiture de sport ou de luxe. Un Epicure (341/270 av. J.C.) dirait qu’il désire quelque chose hors de sa portée, qu’il s’agit là d’un « désir non naturel et non nécessaire. » De fait, si un tel désir se manifeste et, surtout, perdure, il peut devenir une souffrance, un « trouble de l’âme », en raison de la frustration induite. Conséquemment, parvenir à l’ataraxie consiste en tout premier lieu à ne désirer que ce qui est à portée de notre désir. Certes... Mais, pourrait-on m’objecter à juste titre, si tous les hommes limitaient ainsi leurs désirs, le progrès, social notamment, serait-il possible ? Si, vivant dans l’injustice, l’homme n’éprouvait pas le désir de justice, celle-ci pourrait-elle s’imposer ? Ces questions confrontent la notion d’ataraxie à son immense ambiguïté. En effet, si elle est l’une des filles de la sagesse, elle ne concerne que la personne et non pas une communauté ou une classe sociale. Mais, si elle n’est que cela, n’est-elle pas une utopie ? En d’autres termes, le bonheur des uns est-il possible alors que le malheur frappe tant d’autres ? Considérée sous un angle plus psychologique, l’ataraxie ne fut-elle pas la manifestation d’un égoïsme, indifférent au destin de la cité ? « Vivre caché », préconisait Epicure... Mais alors, pourrait-on me dire, si l’ataraxie est une utopie, voire l’expression d’un égoïsme, pourquoi s’y intéresser ? Que peut-on en attendre ? Si l’on considère l’ataraxie en soi, rien ! Mais, si l’on veut bien mettre en perspective ce que nous sommes avec cette notion, il devient alors possible de réfléchir sur notre vie présente et, peut-être, de mieux se défendre contre les effets dévastateurs d’un système socioculturel caractérisé par le besoin démentiel de consommer. Consommer, aujourd’hui, n’est même plus la satisfaction d’un désir mais bien davantage la marque d’une addiction. Le bonheur n’est-il devenu que cela ?
Il serait possible d’aborder directement notre réflexion sur l’ataraxie (donc, sur le bonheur). Cependant, procéder ainsi reviendrait à méconnaître les liens étroits tissés entre la physique (au sens antique du terme, nous y reviendrons bientôt) et l’éthique : « Mais il n’est pas possible de nous délivrer des craintes suscitées par les grands problèmes, nous dit Epicure, si nous ne savons pas la nature de l’univers (...) en sorte qu’il est impossible de goûter les plaisirs purs sans la connaissance de la physique (Lettre à Ménécée. Diogène Laërce. p. 266) » De fait, l’éthique de la philosophie antique est indissociable de l’idée que les philosophes de l’époque se faisaient du monde. Pour nous, modernes, je conçois qu’il soit difficile de se représenter exactement ce mode de pensée. Pour la majorité d’entre-nous, l’acquisition du bonheur (si celle-ci est possible) ne dépend plus de notre connaissance du monde mais bien davantage de ce que nous consommons et possédons. (Faut-il s’en réjouir.. ?). Aujourd’hui, la physique n’est plus seulement vouée à la connaissance formelle de la nature mais à la découverte de ses lois (la gravitation universelle de Newton, par exemple). A la différence de la physique moderne, celle de l’Antiquité ne disposait ni d’outils mathématiques ni d’instruments d’observation. Cette physique reposait essentiellement sur l’énonciation de principes non-assujettis à la méthode expérimentale. C’est pourquoi un Héraclite (6è/5è av. J.C.), par exemple, pu décréter, sans plus de preuves, que le feu était le principe premier d’où découlaient toutes les manifestations de la nature. Bien qu’ayant partagé en partie le pré-relativisme d’Héraclite, Lucrèce (1er siècle av. J.C.) ne put s’empêcher de s’inscrire en faux contre cette explication des plus élémentaire : « Dire que le feu est tout, ne vouloir admettre que le feu au nombre des existences réelles, comme le fait Héraclite, me paraît le comble de la folie. (De la nature, livre premier, 690). » A cette époque, donc, il suffisait d’affirmer sans prouver. Dès lors, et en raison même de (l’apparente) facilité de son approche, il devient compréhensible que la connaissance (réelle ou supposée) de la nature (la physique) pu servir de base à une éthique vouée, elle, au bonheur de l’homme.
Jeter les bases, même rudimentaires, d’une physique exigea en amont de se détourner de l’omniprésence des dieux. Et, c’est à un groupe de philosophes (les présocratiques. 6e/5e siècles av. J.C.) que nous devons cette révolution intellectuelle. Dès lors, et même si le divin ne disparut jamais complètement, le réel, la réalité perceptible, furent conçues à partir des phénomènes observés par les hommes. Ayant perdu leur pouvoir architectonique (qui relève de l’architecture), les dieux furent condamnés à une errance solitaire jusqu’à ce que Platon (327/374 av. J.C.) ré instaure une partie de leur autorité par le truchement de son monde intelligible et cela au détriment du corps désormais relégué au rang d’enveloppe creuse.
Ceci étant, les penseurs présocratiques ont été confrontés à un redoutable problème. En effet, ne plus recourir aux dieux pour expliquer les phénomènes produits par la nature conduisit ces penseurs à imaginer des causes, non plus issues du ciel, mais de la terre. Et, de ce bouleversement, de cette responsabilité nouvelle échue à l’homme, naquit la philosophie. Pour ne prendre qu’un seul exemple, attardons-nous sur Thalès de Milet (7è/6è av. J.C.). Ce philosophe issu de la célèbre école de Milet (sise sur la façade ouest de l’Asie Mineure) fut considéré par Aristote (384/322 av. J.C.) comme le fondateur de la philosophie des “physiciens” (ou “physiologues”). Bien évidemment, il serait des plus maladroit de considérer Thalès comme étant un physicien au sens moderne de ce terme. Durant la période qui nous occupe (7è/6è av. J.C., rappelons-le) la physique (du grec phusis ou nature) consistait à observer le monde tel qu’il était et tenter de découvrir une cause première susceptible d’expliquer les multiples transformations de ce même monde. Pour Thalès, cette cause première, ce principe, devrait-on plutôt dire, fut l’eau : « (...) Thalès a le mérite de partir, pour expliquer l’univers, de l’eau, primordiale et primitive, qui par un processus physique, engendre la terre, l’air, le feu, ces deux derniers n’étant que des exhalations de l’eau, dont la terre de son coté, est le dépôt résiduel (Jean Voilquin. Penseurs grecs avant Socrate. p. 46) ». Avec sa corrosivité et sa lucidité habituelle, Nietzsche (1844/1900) ne manqua pas de noter l’importance historico-philosophique d’une telle approche : « La philosophie grecque semble commencer par cette idée absurde, que l’eau serait l’origine et le sein maternel de toute chose. Y a-t-il lieu de s’y arrêter et de la prendre au sérieux ? Oui, et pour trois raisons : d’abord parce que c’est un axiome qui traite de l’origine des choses, parce qu’il en parle sans image et sans fable... (Naissance de la philosophie à l‘époque de la tragédie grecque. p. 34) ».
Dès lors, les bases de la physique antique (l’hylozoïsme - ou pensée selon laquelle le monde et la matière seraient pourvus d’une vie propre -, convient mieux) furent établies. Mais, et parallèlement à cette physique, une réflexion sur l’homme ne tarda pas à s’instaurer. C’est ainsi que l’on prête à Thalès la paternité du fameux apophtegme (parole mémorable) reprit par Socrate (470/399 av. J.C.) : « Connais-toi toi-même ». Si l’on veut bien s’attarder un instant sur cette célèbre maxime, il apparaîtra bien vite qu’elle établit un lien entre le monde et l’homme. En effet, pourrait-il véritablement se connaître s’il méconnaissait sa relation avec un monde dont il est l’une des conséquences ? Il en découle que se connaître implique à la fois agir en fonction de cette connaissance (but de l’éthique) et connaître ce qui nous entoure (but de la physique).
L’ataraxie étant une doctrine émanant directement de la recherche du bonheur, son étude ne peut faire abstraction de cette notion ; Oh combien universelle ! C’est pourquoi j’ai consacré le premier chapitre de cet article à cette recherche qui nous concerne tous. Ensuite, nous nous pencherons sur Démocrite (vers 460/380 av. J.C.) inventeur d’une physique, révolutionnaire pour l’époque, tout en étant le précurseur d’une éthique qui parviendra à sa maturité avec Epicure. Et c’est justement avec ce grand philosophe que nous poursuivrons notre cheminement dans les sentes entremêlées de l’hédonisme et de l’eudémonisme. Bien que je ne sois guère enthousiasmé par le « supporte et abstiens-toi.. !!! » des stoïciens, je ne peux occulter cette grande école philosophique. C’est pourquoi un chapitre lui sera consacré. Par contre, j’ai renoncé à inclure un chapitre concernant Lucrèce. En effet, en raison des relations très étroites existant entre ce penseur et Epicure, une telle insertion aurait comporté beaucoup trop de « redites. » A regret, je dois en convenir, j’ai également décidé d’exclure le pyrrhonisme. Pourquoi une telle décision ? Parce que, et en dépit de la grande estime que je porte à ce courant philosophique, le scepticisme fondé par Pyrrhon (~340-275 av. J.C.) est une doctrine complexe qui mérite, à elle seule, la rédaction d’un article spécifique. Sans doute, serais-je amené à le rédiger.
Bien que je n’envisage pas de lui consacrer un chapitre, l’hédonisme (doctrine faisant du plaisir le souverain bien de l’homme) de l’école des cyrénaïques (début du 4è siècle av. J.C.) sera toujours en filigrane au fil de ce texte. Contrairement à mon précédent article, j’ai choisi d’inclure un grand nombre de citations afin de ne pas trahir la pensée des philosophes évoqués. Certaines seront sujettes à une interprétation alors que d’autres seront laissées à l’appréciation de la lectrice ou du lecteur. Enfin, je souhaite vivement que ce texte saura clairement parler du bonheur car, finalement, ne vit-on pas pour être heureux ?
REFLEXION AUTOUR DE LA NOTION DE BONHEUR
« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. (...) Celui qui dit qu’il n’est pas encore ou qu’il n’est plus temps de philosopher, ressemble à celui qui dit qu’il n’est pas encore ou qu’il n’est plus temps d’atteindre le bonheur. On doit donc philosopher quand on est jeune et quand on est vieux (...) Il faut donc étudier les moyens d’acquérir le bonheur, puisque quand il est là nous avons tout, et quand il n’est pas là, nous faisons tout pour l’acquérir » ( Diogène Laërce. Vol. 2 p. 258).
Ces toutes premières lignes nées sous la plume d’Epicure au début de sa lettre adressée à Ménécée illustrent l’un des objectifs essentiels assignés au sage épicurien et, d’une manière plus générale, à la philosophie antique : la recherche du bonheur. Ceci étant, et de l’aveu même d’Epicure : « Il faut donc étudier les moyens d’acquérir le bonheur... », il ne suffit pas de vouloir être heureux pour l’être aussitôt. Par conséquent, et si l’on peut considérer le bonheur comme une aspiration partagée par tous, l’acquérir ne s’avère pas aussi simple. D’ailleurs, cette difficulté n’échappa pas à Aristote (384-322 av. J.C.), qui se demanda (Ethique de Nicomaque I/ CHAP. IX.) si : « Le bonheur était susceptible d’être enseigné, d’être acquis par l’usage ou à la suite de quelque entraînement. » Il ressort de ces réflexions que les choses ne sont pas aussi simples et cela peut paraître bien paradoxal dans la mesure ou les multiples réitérations du mot bonheur en font un lieu des plus communs. Pourtant, lorsque l’on prononce ce mot de quoi parle-t-on véritablement ? Est-il opposé au plaisir ou lui est-il associé ? Est-il le bien suprême ou n’est-il qu’une partie, avec la vertu, de ce concept des plus indéfinis ? Mais, en tout premier lieu, le bonheur existe-t-il ou n’est-il qu’un mythe coriace ayant su survivre au temps ?
Remarquons tout d’abord l’ambiguïté soulevée par l’étymologie du mot bonheur. Issu à la fois du préfixe “bon” (du latin bonus) et du suffixe “heur” (du latin augurium ou présage, chance), ce terme signifierait donc bénéficier d’un bon présage ou d’une bonne chance. Si nous nous arrêtons à ce point de vue strictement étymologique (recherche de l’origine et de l’histoire des mots), acquérir le bonheur ne pourrait dépendre de nous. En effet, qu’est un présage sinon la manifestation de quelque chose dont nous ne sommes pas le maître ? Considéré sous cet angle, le bonheur ne serait donc accessible qu’aux êtres “chanceux” et inaccessible à tous les autres. Et, si cela était, le rechercher serait pour le moins utopique ce qui donnerait raison à Tchekhov : « Nous ne sommes pas heureux, et le bonheur n’existe pas ; nous ne pouvons que le désirer. »
Ceci étant, désirer le bonheur peut se concevoir. Remarquons, cependant, que désirer le bonheur ne revient pas à désirer une chose clairement définie. En effet, qu’est le bonheur ? Est-il une “récompense”, comme le pensa Saint Exupéry ? “Le moyen de la vie”, comme le suggéra Paul Claudel ? Le “fondement de notre liberté”, comme l’écrivit le philosophe anglais John Locke (1632/1704) ? Ou, si l’on veut bien suivre Aristote (Ethique de Nicomaque), est-il le désirable absolu, le souverain bien, c’est à dire à la fois le bien le plus grand et le bien ultime ? Si donc le désir du bonheur est unanimement partagé, peu d’hommes s’accordent sur son objet : « Mais sur la nature même du bonheur, nous dit encore Aristote, on ne s’entend plus et les explications des sages et de la foule sont en désaccord. Les uns jugent que c’est un bien évident et visible, tel que le plaisir, la richesse, les honneurs ; pour d’autres la réponse est différente ; et souvent pour le même individu elle varie : p. ex. malade il donne la préférence à la santé, pauvre à la richesse. (Ethique de Nicomaque I/ CHAP. IV) » Cela n’est guère surprenant dans la mesure ou le bonheur ne renvoie qu’à lui-même. Il est sa propre cause et sa propre fin. « Le bien parfait, écrivit Aristote, est ce qui doit toujours être possédé pour soi et non pour une autre raison. Tel paraît être, au premier chef, le bonheur. Car nous le cherchons toujours pour lui-même, et jamais pour une autre raison. (Ethique de Nicomaque I/CHAP. VII) » Le bonheur apparaît donc être le bien suprême auquel tout homme tend. En termes modernes, il est la seule finalité existentielle capable de procurer une paix indicible et heureuse. Son absence ne peut jamais être compensée par quoi que ce soit. Il est « La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, » pensa Jean Jacques Rousseau (1712/1778) et, même avec « les yeux fermés (Paul Valéry) », il parvient à éclairer le chemin de la vie. Cela dit : Tout le monde est-il fait pour être heureux ? Ou, n’est-il qu’un « Don des dieux ou un heureux hasard de la fortune ? (Aristote : Ethique de Nicomaque I/CHAP. IX) » En d’autres termes, faut-il avoir de la chance pour être heureux ? Et, dès lors, combien d’êtres humains n’auraient d’autre destin que de l’espérer : « Certains ne sont heureux, écrivit Saint-Augustin (354/430 apr. J.C.), qu’en espérance. C’est une façon de l’être inférieure à celle des hommes qui le sont effectivement, mais qui vaut mieux que la condition de ceux qui ne sont heureux ni en fait, ni en espérance. Cependant ceux-là, s’ils étaient tout à fait étrangers au bonheur, ne le voudraient pas ainsi, et ils le veulent, c’est bien certain. (Confessions X/XX) » Nous ne pouvons que saluer le pragmatisme et le réalisme (ces deux termes sont entendus dans leur sens ordinaire) du célèbre évêque d’Hippone. Ceci étant, l’espérance incarne l’échec de l’action et de la volonté qui la sous-tend. “Acte de foi”, selon Marcel Proust, l’espérance est une attente, une croyance dans un avenir supposé meilleur. Elle traduit l’incurie d’un présent qui se dérobe pour se réfugier dans un lendemain espéré plus clément. Elle est le témoin embué de tristesse de l’impuissance de l’homme écartelé entre le désir et l’impossibilité de le satisfaire. Fille non souhaitée du “principe de réalité”, l’espérance marque toujours la limite du vouloir-être bien. Mais, elle n’est pas qu’espoir ; elle est également doute et crainte. Car, celui qui espère n’est jamais assuré d’avoir raison d’espérer. En fait, l’espérance est une pure virtualité qui implique à la fois une conscience et un déni du réel. Espérer revient à considérer que ce réel ne pourra indéfiniment perdurer. Je ne suis pas heureux ? Certes ! Mais il “va se produire quelque chose” qui va inverser le cours de ma vie. Dès lors, l’espérance est un désir mais un désir portant sur l’avenir, une “passion” disaient les stoïciens pour lesquels ce terme désignait l’éloignement de l’âme de la nature donc, de la vie.
Ceci posé, est-il si déraisonnable d’espérer le bonheur lorsque l’on est malheureux ? Serait-il plus raisonnable de s’accommoder de l’absence du bonheur et de “cesser d’espérer afin de cesser de craindre” comme le prôna le philosophe Hécaton (1er siècle av. J.C.) (Cité par Sénèque : lettre 5 à Lucilius) Car, une fois encore, espérer, c’est à dire, désirer le bonheur, ne peut avoir de sens si l’on ignore ce que l’on espère et donc, ce que l’on désire. Toute l’ambiguïté qui émane du terme bonheur réside dans cette contradiction : je désire quelque chose mais je méconnais totalement ce qu’est ce quelque chose. De plus, l’homme n’est homme que dans le temps ; hors du temps, il n’est plus rien. Il en va de même pour le bonheur mais, lui, peut n’être rien dans le temps. Dès lors, on peut comprendre qu’un homme puisse vivre sans le bonheur soit parce qu’il ne l’a jamais connu ou, tout simplement, parce qu’il l’a perdu. Car, et comme l’affirma Héraclite : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Fgt 91 »), tout ce qui vit est mouvant. Et, de fait, en étant toujours en perpétuel mouvement, l’homme est instable ce qui l’expose très souvent à de redoutables revers de fortune : « (...) On ne veut pas déclarer heureux les vivants par suite des changements qui se produisent dans l’existence, nous dit Aristote, par le fait aussi qu’on attribue au bonheur je ne sais qu’elle stabilité soustraite à tout changement, alors que la roue de la fortune tourne même pour les gens heureux (Ethique de Nicomaque I/ CHAP. X) » Aristote eut raison : l’homme heureux ne peut jamais être assuré de le rester ce qui fonde sa crainte de ne plus l’être.
Plus ou moins consciemment, un homme à la recherche du bonheur sait qu’il ne le détient pas. Et, il suffit de porter le regard autour de soi pour s’apercevoir que beaucoup d’entre-nous souffrent de cette absence. C’est ici que la philosophie s’inscrit pleinement dans sa propre dramaturgie : pourquoi les hommes sont-ils malheureux et pourquoi leur est-il si difficile d’être véritablement heureux ? Qu’elle réponse apporter à ce constat ? Et, en filigrane, qu’elle est la place réelle du bonheur au cours de la vie humaine ? Ne relèverait-il que d’un constat à posteriori comme le suggéra Solon (Evoqué par Aristote - Ethique de Nicomaque I/ CHAP. X - ce législateur et poète athénien (7ème/6ème siècles av. J.C.) soutint que l’on ne pouvait déclarer un homme heureux de son vivant en raison de sa vulnérabilité.) « Nous n’affirmons pas, précisa Aristote, que le mort est heureux et ce n’est pas cela que Solon veut dire : il veut faire entendre que l’on ne peut juger sûrement heureux un être que dans la mesure où il se trouve désormais soustrait aux maux et aux revers de la fortune (Ethique de Nicomaque I/ CHAP. X) » D’un pessimisme encore plus radical, l’Ecclésiaste (~ 3ème siècle av. J.C.-) se demande si la vie vaut la peine d’être vécue. En effet, et bien qu’il ait connu les joies de la vie (plaisirs, richesses), Qoheleth finit par penser que tout est inutile (la sagesse étant de ce point de vue bien vaine) et la mort inévitable. Sans doute, atteignons-nous ici la limite naturelle du bonheur. En effet, est-il possible d’être véritablement heureux tout en ayant conscience de notre propre fin ? Epicure, l’un des plus grands philosophes de l’Antiquité, tenta de limiter les conséquences désastreuses de cette conscience : « Habitue-toi en second lieu à penser que la mort n’est rien pour nous puisque le bien et le mal n’existent que dans la sensation. (...) Ainsi donc, le plus effroyable de tous les maux, la mort, n’est rien pour nous, puisque tant que nous vivons, la mort n’existe pas. Et lorsque la mort est là, alors, nous ne sommes plus. (Lettre à Ménécée. Diogène Laërce. Vol. 2. P. 259 » Si la finesse et la pertinence de ce raisonnement sont incontestables, ils se heurtent toutefois au pouvoir souvent destructeur de l’imagination. C’est que cette "folle du logis" (Malebranche) a besoin de représentations mentales (d’images) pour édifier un univers appartenant à la fois au réel en acte et à un autre réel en puissance. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le sculpteur étudie un bloc de marbre. La pierre est là, devant lui, bien réelle (en tant cause matérielle, dirait Aristote) mais, en même temps, la statue qui va naître habite déjà l’esprit de l’artiste. Or, “l’image” de cette statue ne surgit pas de nulle part. Elle est constituée d’un ensemble d’images précédemment perçues dont elle réalise la synthèse. (Le rêve relève d’un processus identique) Ceci étant, la mort n’est pas une statue. Tenter de se la représenter serait bien vain puisque nul ne peut se prévaloir d’en détenir ne serait-ce qu’une image. (L’image projetée par un défunt renvoie à une mystérieuse – et angoissante – immobilité ; celle du soldat tombé sur le champ de bataille dévoile les blessures du corps et la peur de les subir soi-même mais, ni l’une, ni l’autre, ne révèle la transition si redoutée qui conduit de la vie à la mort) Alors, si du point de vue logique, le conseil d’Epicure semble être des plus pertinents, en revanche, il implique un déni de l’imagination. Mais, une telle sagesse est-elle véritablement accessible ou, n’est-elle qu’une utopie ? En d’autres termes, l’homme est-il fait pour vivre dans un présent insoucieux d’une absence de présent ? Si cela était, il se contenterait tout simplement de vivre sans se préoccuper de ce qui n’est pas à sa portée. C’est l’option que prônèrent les stoïciens et les épicuriens : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur ces choses. Ainsi, la mort n’a rien de redoutable puisque, même à Socrate, elle n’a point paru telle. Mais le jugement que nous portons sur la mort, en la déclarant redoutable, c’est là ce qui est redoutable » écrivit le stoïcien Epictète (Frag. 5). Dans la réalité, les choses sont bien différentes car l’homme a besoin d’une réponse à ses doutes et à ses angoisses. Si donc les hommes considèrent que la mort est redoutable, c’est parce qu’ils ne peuvent se la représenter et n’ont pas la sagesse de s’en moquer. Alors, désemparés face à la certitude du futur non-être qui les guette, ils tentent de se rassurer en se tournant vers la religion en oubliant, toutefois, que la vie n’est qu’une passerelle entre deux néants. Certains se consolent en espérant un improbable salut dans la “Cité céleste” de saint Augustin ; d’autres s’enlisent dans l’espérance d’une “réincarnation” (dont l’utilité, au demeurant, est loin d’aller de soi) ; d’autres, encore, mais d’une manière plus générale, tentent de se convaincre d’une vie future dans l’au-delà : « Il n’est de bonheur dans cette vie, écrivit Pascal (1623/1662), que dans l’espérance d’une autre vie. » Sont-ce donc des voies conduisant au bonheur ou seulement des palliatifs voués à compenser son absence ? En d’autres termes, la croyance peut-elle rendre heureux ? Peut-être le pourrait-elle si elle était en acte c’est à dire, réalisée. Mais, force est de constater qu’elle ne repose que sur une espérance qui, il faut bien le reconnaître, a toutes les chances de ne jamais aboutir.
Il semblerait donc que l’espérance et la conscience de la mort aillent à l’encontre du bonheur. Et, dans la mesure ou l’une et l’autre accompagnent la destinée humaine, la question du bonheur se pose-t-elle vraiment ? Si nous faisons abstraction de la seconde, la première (l’espérance) apporte un début de réponse. En effet, espérer le bonheur revient à prendre acte d’un manque : si je ne suis pas heureux c’est que je souffre d’un manque de bonheur. Dès lors, on peut penser qu’une réflexion sur le bonheur commence par l’expérience de son absence. Pourtant, et même lorsqu’il a conscience d’être malheureux, l’homme persiste à vivre et, parfois même, joyeusement. Qu’est-ce à dire ? Que le bonheur, même s’il est inlassablement recherché, ne serait pas indispensable et qu’il vaudrait mieux « Rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri » ? (La Bruyère) Et donc, que le bonheur ne serait « qu’une récompense et non, un but » ? (Saint-Exupéry) Sans doute, est-il un peu de cela, une sorte de couronnement, quelque chose qui survient alors que l’on ne s’y attendait pas. Mais, une fois encore, comment expliquer que tant d’hommes puissent vivre à peu près sereinement sans le bonheur ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut préalablement se demander ce qui convainc l’homme de continuer à vivre et surtout de persister à perpétuer son espèce. Ici, une réponse s’impose d’elle-même : le désir et le plaisir qui le réalise. L’homme n’est que désir parce qu’il est manque. Il désire manger, parce qu’il a faim ; boire, parce qu’il a soif ; dormir, parce qu’il a sommeil, s’enlacer, parce qu’il a envie de faire l’amour et vivre, parce qu’il a peur de ne plus vivre. La beauté de l’homme, son coté émouvant, résulte de ses désirs qui reflètent sa fragilité. En raison même de ce qu’il est, l’homme est incomplet. Pour vivre, il a besoin de la nature qui le nourrit et de ses semblables qui l’accompagnent durant toute sa vie. Si l’homme recherche le bonheur, il recherche bien davantage la non-solitude car il sait que, naufragé solitaire, il n’a aucune chance de survivre et encore moins d’être heureux.
Une forme du bonheur ne serait donc qu’une accumulation de désirs accomplis accompagné de la certitude de toujours pouvoir les assouvir. Et, de ce point de vue, ce que l’on appelle “la crainte du lendemain” reviendrait à redouter de ne plus pouvoir jouir de la vie : le dénuement favorise la faim ; la solitude prive de l’amitié et de l’amour ; le temps qui passe restreint l’espérance de vie... Alors, peut-être, Dostoïevski eut-il raison de penser que : « L’homme est malheureux parce qu’il ne sait pas qu’il est heureux » ce qui revient à dire qu’être heureux consiste à avoir conscience de n’être point malheureux. Si cette pensée est exacte, elle implique qu’être heureux signifie vivre non pas pour être heureux mais, tout simplement, vivre pour vivre. Le bonheur ne pourrait donc résulter d’une espérance mais, au contraire, serait un acte, l’acte de vivre le plus conformément possible à ses désirs « Le bonheur, écrivit le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588/1679), est une continuelle marche en avant du désir. » Seulement, comme la sagesse ne semble pas être l’apanage du plus grand nombre d’entre-nous, les désirs ne sont pas toujours raisonnables. Certains, même, conduisent parfois aux pires extrémités : le viol, par exemple. En effet, qui pourrait affirmer qu’il ne soit pas mû par un désir dont l’assouvissement implique pourtant la destruction de son objet ? Alors si le bonheur n’est pas accessible à tout le monde, l’assouvissement naturel des désirs l’est-il ? En d’autres termes, le nécessiteux et le riche ont-ils les mêmes chances d’apaiser leur faim ? Et, la parcelle de bonheur qui pourrait en résulter est-elle égale pour tous les deux ? Alors, et de toute évidence : « Le bonheur ne saurait se passer des biens extérieurs (...) En effet, il est impossible ou tout au moins difficile de bien faire si l’on est dépourvu de ressources. Car bien des actes exigent, comme moyen d’exécution, des amis, de l’argent, un certain pouvoir politique. Faute de ces moyens, le bonheur de l’existence se trouve altéré, par exemple si l’on ne jouit pas d’une bonne naissance, d’une heureuse descendance et de beauté » (Aristote. Ethique de Nicomaque : I/ CHAP. VIII). De fait, que l’on évoque le bonheur ou le plaisir qui le sous-tend, force est d’admettre que tous deux baignent dans l’universelle injustice de la condition humaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, écrivit La Fontaine, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Si donc, le plaisir peut exister sans le bonheur, et non l’inverse, tous deux sont assujettis à la bonne ou mauvaise fortune. Non plus celles dispensées par la chance ou une quelconque divinité, mais par celles octroyées par la condition humaine.
Parvenus à ce point de notre réflexion, nous pouvons avancer que la notion de bonheur semble indissociable du triptyque existentiel qui conditionne la vie humaine : le manque, le désir et le plaisir. En effet, le manque provoque le désir de ce qui nous manque (le manque de nourriture induit le désir de nourriture) ; l’obtention de ce qui nous manque satisfait le désir et conduit au plaisir (l’absorption de nourriture revient à satisfaire le désir de se nourrir et provoque un plaisir proportionnel à ce désir). On peut, dès lors, considérer que l’annulation du manque ouvre la porte à une certaine forme de bonheur. A la condition, toutefois, d’être assuré de toujours pouvoir renouveler ce cycle. (D’où, d’ailleurs, la peur de perdre cette possibilité) Seulement, si cette thèse est intellectuellement confortable, elle a pour inconvénient d’assujettir le bonheur à la foule de désirs qui habite l’homme. Le désir de manger, de boire, de faire l’amour, de penser etc. Cette difficulté n’a pas échappé à Platon (427/347 av. J.C.) : « Mais, pour le plaisir, je sais qu’il est varié, et, puisque, comme je l’ai dit, nous commençons par lui, il faut considérer et rechercher qu’elle est sa nature. A l’entendre ainsi simplement nommer, c’est une chose unique, mais il est certain qu’il revêt des formes de toutes sortes et, à certains égards, dissemblables entre elles » (Philèbe. 12d) A la suite de la thèse platonicienne, Epicure a tenté d’établir une hiérarchie des désirs : « Il faut en troisième lieu comprendre que parmi les désirs, les uns sont naturels et les autres vains, et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, et les autres seulement naturels. Enfin, parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, les autres à la tranquillité du corps, et les autres à la vie elle-même » (Lettre à Ménécée. Diogène Laërce. Ibid. p. 260) » Si l’on veut bien suivre Epicure, le manque de bonheur provoque le désir du bonheur ; le manque de tranquillité du corps provoque le désir de son apaisement et le manque de “bien vivre” induit le désir de mieux vivre. Malheurement, et en dépit de sa finesse, cette classification ne nous éclaire guère sur l’objet du désir de bonheur (nous y reviendrons lors du chapitre consacré à l’Epicurisme).
S’il est bien un domaine où le manque se manifeste clairement, c’est celui de l’amour. Chaque être passe sa vie à rechercher un autre être susceptible de le compléter et tente de le garder lorsqu’il pense l’avoir découvert. Cette problématique est à ce point universelle que Platon n’a pu s’empêcher de l’aborder dans l’un de ses dialogues : Le banquet. Comme à son habitude, le grand philosophe a bien évidemment recouru aux performances allégoriques de ses mythes. Celui d’Aristophane (Le banquet 189d/193c), est une extraordinaire allégorie (représentation d’une idée à l’aide d’images) censée expliquer l’irrésistible attirance que les êtres manifestent les uns envers les autres. Bien qu’il ne me soit pas possible ici de raconter ce mythe en détail (je conseille vivement au lecteur de lire le Banquet) il est malgré tout utile d’en retracer les grandes lignes. « Au temps jadis, nous dit Aristophane, notre nature n’était pas la même qu’aujourd’hui (...) Il y avait trois catégories d’êtres humains et non pas deux comme maintenant, à savoir le mâle et la femelle. Mais il en existait une troisième qui participait des deux autres » (Ici, Aristophane évoque les androgynes, sorte de synthèse des deux premières catégories). Plus avant dans le mythe, Aristophane raconte que, fortement contrariés par le comportement des créatures humaines, les dieux (Zeus, en tout premier lieu) décidèrent de couper ces créatures en deux afin de les affaiblir. A partir de ce moment, les moitiés ainsi obtenues ont, sans cesse, essayé de retrouver leur unité perdue : « Ce souhait s’explique, poursuit Aristophane, par le fait que la nature humaine qui était la nôtre dans un passé reculé se présentait ainsi, c’est à dire que nous étions d’une seule pièce : aussi est-ce au souhait de retrouver cette totalité, à sa recherche, que nous donnons le nom d’ "amour" ». La beauté de ce mythe résulte à la fois de sa puissance allégorique et de sa fonction gnoséologique (théorie philosophique de la connaissance). En effet, rechercher une quelconque fantaisie chez Platon serait des plus vains. L’amour dont nous parle Aristophane n’est en rien “l’amour pathologique” de Kant (1724/1804) qui repose à la fois sur un désir irraisonnable et sur le mépris de l’objet de ce même désir. Marque évidente du manque de l’être absent, l’amour platonicien est un mouvement vers cet être. Mais, au-delà de cet objet de désir, cet amour vient compléter la “dialectique ascendante” afin de promouvoir la contemplation de l’intelligible et, notamment, de la beauté en soi. Chez Platon, aimer un autre être que soi revient à aimer le beau et le bien. De la sorte, l’amour platonicien est bien plus qu’une affaire de corps, il constitue l’une des deux voies conduisant à la contemplation de “l’Un-Bien” (chez Platon, cette notion désigne un principe inconditionné – donc, sans cause – qui serait l’expression d’une transcendance absolue. Cette conception quasiment mystique du monde sera très largement “récupérée” par les chrétiens pour lesquels il existe un monde terrestre et un monde “céleste” censé transcender le premier.) Cependant, et bien qu’une telle conception soit supposée favoriser l’acquisition du bonheur éprouvé par le sage (celui de connaître vraiment et d’aimer connaître), force est de constater qu’elle n’est qu’une utopie. Pourquoi ? Parce que l’amour n’a que faire de la transcendance (l’amour de dieu étant la plus grande des supercheries). La vocation première de l’amour est de lier des créatures et, surtout, d’unir des corps (tant que cela est possible, il est vrai). L’amour est désir, plaisir. Et, lorsqu’il s’assagit, il devient souvent une tendresse perlée d’une douce mélancolie. Alors, si la raison n’éclaire que la raison, l’amour n’aime que l’amour. Donc, serait-il le bonheur ? Hélas ! Non ! Bien que... Toutefois, et rappelons-le : « Le bonheur doit être placé parmi ce qui est souhaitable en soi, et non pour une autre raison, car il n’a besoin de rien pour être complet et il se suffit entièrement à lui-même. (Aristote. Ethique de Nicomaque X/ CHAP. VI) ». Par conséquent, et si l’on veut bien suivre Aristote, l’amour ne peut être l’objet du bonheur puisque celui-ci n’a pas d’objet. Par contre, le bonheur est-il concevable sans l’amour ? Et, inversement, l’amour est-il le garant du bonheur ? Sans doute, parfois l’est-il. Notamment lorsqu’il parvient à réaliser une symbiose (union étroite entre des êtres) d’une solidité telle que rien ne puisse l’altérer. Un tel amour s’inscrit dans l’élan décrit par Aristophane car il restaure l’unité primordiale qui en est le moteur. Lorsque l’on a la chance de l’éprouver, de le vivre, l’espérance devient enfin inutile car, peut-on espérer ce que l’on détient ? Dans ce cas, même l‘idée de la mort ne peut assombrir la vie car cette vie se suffit à elle-même. Alors, si pour Platon, le désir est manque, l’amour véritable est le désir sans manque car je désire ce que j’ai. Désirer ce que l’on a, voici, peut-être, l’une des clés du bonheur mais, combien parmi nous ont-ils la sagesse de réaliser la chance qu’une telle sinécure représente ? Combien, parmi nous encore, se connaissent-ils suffisamment pour savoir exactement ce dont ils ont vraiment (et raisonnablement) besoin ? Etre heureux, finalement, ne revient-il pas à désirer uniquement ce que l’on peut avoir ?
Si donc le bonheur demeure ourlé de son propre mystère, l’approcher ne relève pas de l’inconcevable. A la condition, cependant, de ne rien espérer d’autre comme, par exemple, qu’il perdure indéfiniment. En outre, le bonheur n’ayant d’autre but que lui-même, bien sage est celui qui n’essaie pas de lui trouver des attributs. La première marque de sa présence est l’absence de son pendant : le malheur. Lorsque l’on aime, on ne peut souffrir du manque d’amour. Lorsque l’on se nourrit, on ne peut pâtir de la faim. Lorsque l’on boit, on étanche sa soif. Lorsque l’on dort, on apaise son corps. Finalement le bonheur est un ensemble de petits bonheurs dont, pour moi, l’amour est le plus grand. Le bonheur peut se comparer à un puzzle dont chaque pièce est un petit plaisir. Plus on assemble de pièces, plus on est heureux. Ceci étant, peut-on espérer achever ce puzzle ? Finalement, pour vivre heureux, il suffit de vivre ici et maintenant en ayant toujours conscience que voir, entendre, goûter, toucher, sentir sont des merveilleux cadeaux que la nature nous octroie. Et pourtant, combien ces actes vitaux de notre vie sont simples. Si simples, d’ailleurs, que nous avons trop tendance à oublier les bonheurs qu’ils nous procurent. Je suis face à mon ordinateur et j’éprouve un plaisir immense à écrire ces lignes. Je me suis surpris, un peu plus tôt, à m’émerveiller de savoir lire, de pouvoir écrire et de détenir l’extraordinaire faculté de penser. Et, pour couronner tout cela, j’ai également la chance d’aimer et d’être aimé... Je vous l’assure, si je ne puis affirmer être pleinement heureux, je suis convaincu d’être très proche du bonheur. Bien évidemment, cela ne va pas durer indéfiniment mais je ne le demande pas. Vouloir que le bonheur dure toujours revient à souhaiter l’impossible. Et sans doute faut-il éprouver son absence pour mieux en jouir lorsqu’il survient. (En confidence, c’est ce qui m’est arrivé...) Alors, il serait pure folie de l’espérer car, comme je l’ai déjà suggéré, l’espérance est une attente qui entrave les pas de l’action. Or, pour être heureux, il faut le vouloir et surtout se souvenir que le bonheur “idéal” est une utopie. Le bonheur “en soi” est un concept vide, dépourvu de substance puisque dénué d’objet. Le bonheur en soi est un fantasme alors que les petits bonheurs sont la vie. Heureux celui qui en détient beaucoup. Moins heureux est celui qui en détient peu. Mais, au final, l’important n’est-il pas de vivre ? Car, sans la vie, la question du bonheur pourrait-elle se poser ? La vie, précisément, n’est pas la soumission à un quelconque destin (chers stoïciens, ne m’en veuillez pas trop...) Vivre, implique l’effort de vivre comme être heureux implique la volonté de l’être comme aimer implique la volonté d’aimer. L’amour, l’amitié, la fraternité, l’étonnement face aux beautés de la nature, voici, sans doute, quelques clés conduisant à une vie heureuse. Aussi, souvenons-nous « Qu’il n’y a pas de bonheur sans courage, nous dit André Comte-Sponville (La plus belle histoire du bonheur. P. 166), et c’est ce qui donne raison aux stoïciens. Mais il y en a encore moins sans plaisir, c’est ce qui donne raison à Epicure, et sans amour, c’est ce qui donne raison à Socrate (...), à Aristote (« Aimer, c’est se réjouir »), à Montaigne (« Pour moi donc, j’aime la vie »), à Spinoza (« L’amour est une joie »), à Freud (Quand on a perdu la « capacité d’aimer », c’est qu’on est malade), et à nous tous. Le bonheur n’est ni dans l’être ni dans l’avoir. Il est dans l’action, dans le plaisir et dans l’amour ». De fait, qui ouvre son cœur s’ouvre à la vie et devient, dès lors, digne d’être heureux.
DEMOCRITE : ATOMISME ET ATARAXIE.
Remarquons tout d’abord un singulier anachronisme. Bien que contemporain de Socrate (470/399 av. J.C.), et lui ayant survécu entre trente et quarante ans, Démocrite est, la plupart du temps, assimilé à un “présocratique” : « Qu’elle gageure ! » S’est exclamé à juste titre Michel Onfray.. ! - Les sagesses antiques. Vol. 1. - » Abstraction faite de cette curiosité historique, il est important de savoir que rien n’oppose davantage le matérialisme (concernant l’époque, doctrine selon laquelle la matière est la seule réalité) de Démocrite à l’idéalisme platonicien (résultant de son monde transcendant des “Idées”.) Si le réel de Démocrite est à la fois le monde tel que nous le percevons et ce qui le constitue : les atomes et le vide, celui de Platon se trouve dans un ailleurs que l’on peut certes contempler mais à la condition cependant de se détourner du monde sensible ce qui rend caduc les connaissances acquises grâce aux sens. La philosophie platonicienne apparaît de la sorte comme une négation de la réalité car (et comme le suggère le mythe de la caverne) tout ce que nous percevons relève de l’illusion. (Nous sommes confrontés ici à une sorte d’anti-sensualisme - doctrine selon laquelle toutes nos connaissances et idées reposent sur nos sensations -. En réalité, pour Platon, il existe deux mondes : le monde sensible et le monde intelligible. La connaissance véritable ne pouvant être prodiguée que par ce dernier.) Quelque part, une telle conception revient à nier l’évidence de la vie et, entre autres, à rejeter les plaisirs qu’elle peut apporter aux hommes : « Nous avons dit, déclara Socrate – Philèbe 33b -, au moment où nous comparions les genres de vie, qu’on ne devait éprouver aucun plaisir, soit grand, soit petit, quand on avait prit le parti de vivre selon la raison et la sagesse. » Si l’on suit Socrate (donc, Platon), parvenir à la sagesse implique une séparation nette entre les sens (le corps, par conséquent) et la raison. « En séparant brutalement les sens de l’aptitude à la pensée abstraite, donc de la raison, comme si c’étaient deux facultés entièrement différentes, nous dit Nietzsche (La naissance de la philosophie. p. 70), il (Parménide - ~540/450 av. J.C. -) a détruit l’intellect lui-même et poussé à cette distinction entièrement erronée entre l’esprit et le corps, qui pèse, surtout de- puis Platon, comme une malédiction sur toute la philosophie. »
Lointaine aïeule de la micro physique moderne, la physique de Démocrite (qui est aussi, rappelons-le, celle de son maître, Leucippe) expose une conception de la matière absolument révolutionnaire pour l’époque. Nous l’avons précédemment évoqué, les présocratiques ont choisi un élément pour expliquer la génération des phénomènes perceptibles et ce fut déjà un immense progrès par rapport aux croyances antérieures. Mais, et alors que ces éléments faisaient partie du monde visible, les atomes de Démocrite ont été imaginés dans la partie invisible de ce même monde. Et, sans pour cela, recourir à un quelconque soutient divin ou à un archétype plus ou moins transcendant (Platon). Le monde de Démocrite est seulement constitué d’atomes et de vide ; il n’existe rien d’autre : « A l’origine de toutes choses, nous dit Diogène Laërce (Ibid. p. 182), il y les atomes et le vide (tout le reste n’est que supposition). Les mondes sont illimités, engendrés et périssables. Rien ne naît du néant, ni ne retourne au néant. Les atomes sont illimités en grandeur et en nombres et ils sont emportés dans le tout en un tourbillon. Ainsi naissent tous les composés : le feu, l’air, l’eau et la terre. Car ce sont des ensembles d’atomes incorruptibles et fixes en raison de leur fermeté. » Une telle conception de la nature ne laisse que peu de place aux dieux. En effet, dès lors que l’on ne leur attribue plus la création du monde, à quoi pourraient-ils bien servir ? Aussi, et même si leur existence n’est pas complètement bannie, il est inutile de s’en préoccuper. En outre, réduire la réalité au seul monde terrestre rend caduque toute idée de transcendance. On peut comprendre, dès lors, l’hostilité d’un Platon qui ne prit même pas la peine de citer Démocrite (son contemporain, ne l’oublions pas) et envisagea même de brûler tous ces ouvrages... (Diogène Laërce. Ibid. Vol. 2 p. 181)
Comme toujours dans le domaine de la connaissance, une théorie, aussi subtile soit-elle, ne surgit pas de nulle part. Elle s’appuie sur une ou des théories antérieures soit pour les compléter ou les infirmer. C’est ainsi que l’atomisme de Leucippe et de Démocrite s’inscrivit dans la descendance de deux conceptions du monde opposées. Prônée par l’Eléate Parménide (Env. 540/450 av. J.C.), la première privilégia l’existence d’un Etre (par ailleurs très difficile à définir) immuable : « De toute nécessité, nous dit Parménide – Frag. 6, il faut dire et penser que l’Etre est, puisqu’il est l’Etre. Quant au Non-Etre, il n’est rien (...) » Précisant sa pensée, Parménide poursuit : « Il nous reste un seul chemin à parcourir : L’Etre est. Et il y a une foule de signes que l’Etre est incréé, impérissable, car seul il est complet, immobile et éternel (...) L’Etre n’est pas non plus divisible, puisqu’il est tout entier identique à lui-même – Frag. 8 -. » La dernière affirmation de ce fragment (l’Etre est indivisible) est des plus importante car elle établit une filiation entre l’insécabilité de l’atome (qui est donc indivisible) et l’indivisibilité de l’Etre parménidien. Et c’est ainsi que, dans la théorie atomiste, l’Etre de Parménide va être démultiplié à l’infini. (A l’inverse, on pourrait dire que l’être parménidien est un immense et unique atome). Antagoniste de la conception de l’Etre parménidien, la doctrine héraclitéenne plaida en faveur d’un mobilisme (relatif, il est vrai) privilégiant le mouvement : « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. (Frag. 91) » A priori, on pourrait penser qu’Héraclite avait une conception moderne (nietzschéenne, entre autres) du devenir. Cependant, affirmer cela reviendrait à méconnaître à la fois sa conception du logos : « Si ce n’est pas moi mais le logos que vous écoutez, il est sage de reconnaître que tout est un, Frag. 50 » et la notion “d’éternel retour” si chère à l’antiquité. Si donc tout change et se transforme, tout revient : « Le feu vit la mort de la terre et l’air vit la mort du feu ; l’eau vit la mort de l’air et la terre celle de l’eau Frag. 76 » Une telle conception du changement repose sur un finalisme immanent qui, dès lors, peut contourner la question fondamentale du sens. En effet, dans la mesure ou ce qui disparaît va et doit revenir, c’est ce revenir même qui devient le sens du changement. Il existe donc chez Héraclite une logique permettant d’intégrer le mouvement dans une nécessité : « Il faut aussi se rappeler l’homme qui oublie le chemin, nous dit le fragment 71. » Or, ce chemin, précisément, est la voie nécessaire devant être empruntée par tout ce qui existe.
Si donc, dans la conception atomiste de Démocrite, l’être de Parménide n’est pas désavoué (comme tous les atomes, il demeure indivisible et entier), le non-être est accrédité d’une réalité : c’est le vide qui permet le mouvement. (En commettant son “parricide”, Platon tenta de son coté d’apporter une solution au dilemme parménidien : « C’est qu’il nous faudra nécessairement, (...) mettre à la question la thèse de notre père Parménide et prouver (...) que le non-être est sous certain rapport, et que l’être, de son coté, n’est pas en quelque manière – Sophiste 241 d - » Chez Démocrite, les corps qui constituent la nature résultent de l’assemblage des atomes (condition de la vie) ou de leur dissociation (avènement de la mort). Et, quel que soit le processus, tout ce qui est, devient ou péri ne résulte que de causes purement mécaniques. En outre, le perpétuel changement d’Héraclite se trouve également justifié. En effet, celui-ci relève de l’intégration ou de la désintégration des corps atomiques. C’est pourquoi il est possible de considérer la théorie de Démocrite comme une synthèse entre les conceptions parménidienne et héraclitéenne : « De l’éléatisme (Parménide) il (l’atomisme) conserve l’idée d’une permanence et d’une immutabilité de l’être qu’il attribue aux atomes, de l’héraclitéisme il garde l’exigence de la diversité et de la multiplicité sensibles pour rendre compte du changement (Jean Brun : Les présocratiques. p. 113). »
Si, et en raison tant de sa cohérence que de sa solidité, la physique de Démocrite ne laisse guère de place à une certaine forme de relativisme en revanche, il en va tout autrement en ce qui concerne la connaissance des choses. « De la réalité, nous dit Démocrite (Frag. 9), nous ne saisissons rien d’absolument vrai, mais seulement ce qui arrive fortuitement, conformément aux dispositions de notre corps et aux influences qui nous atteignent ou nous heurtent. » Il apparaît ici une très nette distinction entre la connaissance réelle (acquise par la raison) et une connaissance relative issue des sensations : « la couleur n’existe que par convention, nous dit Démocrite (Frag. 125), de même le doux, de même l’amer (...) ». Ce pré-nominalisme (doctrine selon laquelle il n’existe rien d’universel dans le monde en dehors des dénominations des choses) illustre parfaitement la subjectivité des avis formulés à partir des sensations. Un plat donné sera estimé peu salé pour l’un ou trop, pour l’autre. Une eau sera jugée froide ou tiède selon la sensibilité au chaud et au froid du corps. Ainsi donc, si « l’homme est la mesure de toutes choses. (Protagoras. Frag. 1) » il est surtout sa propre mesure et beaucoup commettent l’erreur de l’ignorer. Cette forme d’égocentrisme s’accompagne souvent d’une détestable intolérance. Ce n’est pas parce que je n’ai pas froid que ma compagne est censée ne pas voir froid. Il en va de même pour les jugements esthétiques : ce n’est pas parce que je trouve cet objet laid qu’il l’est forcément pour autrui : « Les choses en elles-mêmes ne sont ni belles ni laides, écrivit Spinoza (1632/1677) Donc, méfions-nous de nous-même, nous sommes bien trop souvent des tyrans qui s’ignorent... »
Bien que je ne partage pas tout à fait l’enthousiasme éclairé de Michel Onfray envers un hédonisme (doctrine selon laquelle le plaisir est le souverain bien de l’homme) qui serait la pierre de voûte de l’éthique démocritéene, je pense utile d’évoquer certains points de son analyse (Les sagesses antiques. Vol. 1. p. 66 et suiv.) « Le réel se constitue d’atomes agencés dans le vide, nous dit-il. La causalité est immanente et matérielle ; il n’existe pas de raison divine ; tout passe, l’éternité est une fiction (...) Les dieux n’existent pas, la fortune comme modalité de la transcendance non plus (...) Pas d’âme séparée du corps, pas de discrédit de la chair (...) Pas de principe nous reliant au divin (...) Pas d’immortel lié au divin (...) L’âme meurt en même temps que le reste du corps (...) Affranchis par la physique qu’on ne saurait craindre les dieux, la nature ni la mort, qu’on peut agir sur les choses pour infléchir leur cours et qu’il existe une puissance du vouloir. » Ces quelques lignes ont pour mérite de dresser la scène d’une éthique de la liberté. En effet, délivré de la transcendance, l’homme est certes seul mais libre de conduire sa vie comme il l’entend. Maintenant, que va-t-il faire de cette vie ? C’est la grande question soulevée par l’éthique de l’antiquité. Le désistement des dieux (leur mise en congé, devrait-on plutôt dire) équivalut à une libération de l’homme. Dès lors, il devint réellement « la mesure de toutes choses » et réussir sa vie, ou non, ne dépendit que de lui comme, d’ailleurs, d’être heureux (à la condition, cependant, de n’être point trop frappé par l’infortune.)
L’homme se retrouva donc face à lui-même. Il essaya de connaître le monde qui l’entourait et s’interrogea sur sa propre destinée. Instinctivement, il rechercha son propre bonheur tout en se doutant, peut-être, de la vanité de sa quête : « Le bonheur parfait est impossible, nous dit un cyrénaïque, car le corps est sujet à cent maladies, l’âme souffre avec le corps, et par la dessus viennent les coups du sort, qui ruinent nos plus belles espérances – Diogène Laërce. Ibid. Vol. 1 p. 137 - » C’est sans doute ainsi que naquit une éthique laïcisée et orientée pour certaines écoles vers l’ataraxie. Chez Démocrite, cette éthique reposa sur la modération en toutes choses : « Pour l’homme, la tranquillité de l’âme (l’ataraxie) provient de la modération dans le plaisir et de la mesure dans le genre de vie. L’insuffisance et l’excès provoquent d’ordinaire des changements fâcheux et causent à l’âme de grands troubles. (...) Il faut donc appliquer son esprit à ce qui est possible et se contenter du présent, ne tenir que peu de compte de ce qu’on envie et admire (...) On doit au contraire avoir sous les yeux la vie des malheureux, songer à leurs criantes misères (...) Aussi faut-il éviter de désirer ce qui ne nous appartient pas, nous contenter de ce que nous possédons (...) En adoptant cette manière de voir, on vivra plus tranquillement et pas mal de calamités nous seront épargnées : l’envie, la jalousie et la haine. (Frag. 191) » Comme l’illustre sans ambiguïté ce fragment, Démocrite assimila l’ataraxie à une modération des plaisirs donc, à une maîtrise des désirs : « Quand notre appétit des richesses est insatiable, nous dit-il encore, il est beaucoup plus redoutable que l’extrême pauvreté. Car plus il est vif, plus violents sont les désirs que nous ressentons. (Frag. 219) » Selon cette sagesse, il faut donc se satisfaire de ce que l’on a : « Sage est celui qui ne s’afflige pas de ce qui lui manque et se satisfait de ce qu’il possède. (Frag. 231 ) » Ou, encore : « Si tu désires peu de choses, ce peu te semblera beaucoup, car des désirs peu exigeants donnent autant de force à la pauvreté qu’à la richesse (Frag. 284) »
Peut-on qualifier l’éthique de Démocrite d’hédoniste ? (Doctrine, rappelons le, selon laquelle le plaisir est le souverain bien). Si l’on se réfère à l’hédonisme radical de l’école cyrénaïque, je ne le pense pas (d’où ma réticence à l’égard du sentiment de Michel Onfray.) Ceci étant, le fragment 189 de Démocrite me confronte à un embarras certain : « Le meilleur pour l’homme est de vivre avec le maximum de joie et le minimum de tristesse. Or, ce n’est pas impossible, si l’on ne place pas le plaisir dans les choses périssables. » Abstraction faite de cette ambiguïté, on peut tout de même comparer les fragments 191 et 284 pré-cités avec la conception du plaisir des cyrénaïques relatée par Diogène Laërce (Ibid. p. 134) : « Ceux qui s’en tinrent aux enseignements d’Aristippe et qui prirent le nom de Cyrénaïques professaient les opinions suivantes : Il y a deux états de l’âme : la douleur et le plaisir ; le plaisir est un mouvement doux et agréable, la douleur est un mouvement violent et pénible. (...) Tous les êtres vivants recherchent le plaisir et fuient la douleur. Par plaisir, ils entendent celui du corps, qu’ils prennent pour fin, et non pas le plaisir en repos, consistant dans la privation de la douleur et dans l’absence de troubles (l’ataraxie) dont Epicure a prit la défense, et qu’il donne comme fin. Ils croient d’autre part que la fin est différente du bonheur : car elle est un plaisir particulier, tandis que le bonheur est un ensemble de plaisirs particuliers, parmi lesquels il faut compter les plaisirs passés et les plaisirs à venir. » Pas de trace ici de la moindre des modérations. Etre heureux signifie rechercher les plaisirs et, notamment, ceux du corps sans tenter de les réguler ou les freiner.
A priori, donc, L’éthique de Démocrite apparaît être davantage un eudémonisme qu’un hédonisme. Cependant, il ne s’agit là que d’une impression car, de même que bonheur et plaisir sont étroitement liés, eudémonisme et hédonisme le sont tout autant. La différence, peut-être, entre bonheur et plaisir résulte du manque de “consistance” objective du premier alors que le second se caractérise précisément par sa consistance sensorielle. Faire l’amour, par exemple, procure un plaisir directement proportionnel au désir qui précède cet acte. Si le plaisir ressenti n’est pas véritablement mesurable, on ne peut cependant nier sa réalité. Seulement, il s’agit, là, d’un plaisir “positif” inscrit dans une logique associant le manque et le désir de combler ce manque. Si le plaisir n’était que cela, les choses seraient beaucoup plus simples. Elles ne le sont pas car il existe une autre forme de plaisir qui, lui, résulte de l’évitement du déplaisir : « Or, nous dit Michel Onfray (Ibid. p. 73), peut-être même existe-t-il plus de satisfactions induites par l’évitement d’une occasion de souffrir, d’avoir de la peine, de craindre ou d’être angoissé, que par la quête positive d’une jubilation identifiée comme telle. Ce plaisir négatif suppose la possibilité de ressentir une réelle satisfaction à ne pas souffrir. L’absence de trouble comme génération de joie compte pour beaucoup dans les éthiques eudémonistes et hédonistes grecques. » De fait, une migraine qui s’estompe grâce à un sédatif procure un plaisir qui repose, précisément, sur la fuite d’un déplaisir.
C’est grâce à ce dualisme fondé sur l’existence d’un plaisir positif et d’un plaisir négatif qu’a pu s’élaborer la notion d’ataraxie. Et, si l’on accepte d’intégrer le plaisir négatif dans le champ de l’hédonisme, Michel Onfray a raison. Si l’on refuse, il faudrait, peut-être, nuancer son propos. Je laisse au lecteur le soin de trancher...
Que l’on prête à Démocrite une intention uniquement eudémoniste, ou associée à une certaine forme d’hédonisme, son éthique est orientée vers l’évitement de tout ce qui pourrait troubler l’âme et de tout ce qui pourrait perturber la sérénité souhaitée. Dans sa doctrine, cette ataraxie alla si loin qu’il n’hésita pas à dissuader d’avoir des enfants : « Je n’approuve pas chez l’homme, nous dit-il, la procréation, car dans le fait d’avoir des enfants j’aperçois de nombreux et considérables dangers ; j’y vois, au contraire, peu de satisfactions (...) – Frag. 276 – ». Dans le fragment précédent (275), il mit en garde (à juste titre, quelque part.. !) contre les inconvénients de l’éducation prodiguée aux enfants : « L’éducation des enfants est chose délicate ; qu’elle réussisse, encore a-t-elle coûté bien des luttes et des soucis ; qu’elle échoue, nous voila devant d’autres chagrins insurmontables. » Ces deux fragments (il en existe d’autres) illustrent parfaitement ce que fut l’ataraxie pour Démocrite : fuir absolument toutes les situations susceptibles d’affecter la tranquillité de l’homme. Si les plaisirs ne sont pas réfutés, ils doivent être soigneusement triés. Il faut se prémunir contre l’envie, contre les jalousies, contre l’accumulation de biens inutiles, contre les terreurs issues de la croyance en la toute puissance de dieux dont l’existence, si elle n’est pas encore niée, est indépendante de celle des hommes. Pour Démocrite, en somme, l‘ataraxie est l’outil d’un bonheur étant « le souverain bien, nous dit Diogène Laërce, ou “euthymie”, très différent du plaisir, contrairement à ce qu’ont cru ceux qui l’ont mal compris, attitude dans laquelle l’âme est en repos et calme, et ne se laisse troubler par aucune crainte, superstition, ou affection (Ibid. Vol. 2 p. 183) »
L’EPICURISME : LA SUCCESSION DE DEMOCRITE
C’est à la fin du 4ème siècle av. J.C. (en 306 av. J.C, exactement), qu’Epicure acheta un jardin à Athènes afin d’y installer son école de philosophie. Conformément à la coutume de l’époque, qui associait le nom de l’école avec le lieu d’où elle émanait, les philosophes épicuriens furent très tôt nommés : “philosophes du jardin”. Grand rival du stoïcisme (qui lui est contemporain), l’épicurisme s’inscrit dans une continuité philosophique dont les précurseurs furent Leucippe et Démocrite (Cf. Supra.) Sans doute transmise par Nausiphanes – disciple de Démocrite qui deviendra le maître d’Epicure - la physique épicurienne fut donc, sinon totalement conforme, du moins très proche de celle prônée par Démocrite. En quoi consiste cette physique qui repose sur la lecture atomiste de l’univers ? En tout premier lieu, Epicure nous fait savoir que : « L’univers est infini (Lettre à Hérodote Diogène Laërce Cf. supra) », qu’il existe : « Une infinité de mondes, soit semblables au nôtre, soit différents (Lettre à Hérodote). » Par ailleurs, nous dit encore Epicure dans la même lettre : « L’univers a toujours été (donc, il est incréé) et sera toujours ce qu’il est actuellement, car il n’existe rien d’autre en quoi il se puisse changer, et il n’y a non plus, en dehors de l’univers, rien qui puisse agir sur lui, pour y opérer un changement. » Maintenant, quels sont les éléments constitutifs de cet univers ? A la suite de Démocrite, Epicure nous dit que : « l’univers est formé de corps (...) et que, parmi les corps, les uns sont les composés, les autres les éléments qui servent à faire les composés. Ces derniers sont les atomes indivisibles (insécables), et immuables, puisque rien ne peut retourner au néant, et qu’il faut que subsistent des réalités quand les composés se désagrègent (lettre à Hérodote). » Donc, selon Epicure, l’univers est incréé, infini, composé d’atomes constitutifs des corps. Certes, mais pour constituer les corps, il faut bien que les atomes puissent se mouvoir. Ici, et toujours à la suite de Démocrite, Epicure nous explique que : « Les atomes sont animés d’un mouvement perpétuel (lettre à Hérodote). » Cette dernière affirmation implique obligatoirement l’existence d’un cadre à l’intérieur duquel les atomes peuvent se mouvoir. Ce cadre, Epicure nous le définit : « Si ce que nous appelons le vide, l’étendue, « l’essence intangible » n’existait pas, il n’y aurait pas d’endroit où les corps pourraient se mouvoir, comme nous voyons en fait qu’ils se meuvent (Lettre à Hérodote). » Plus tard, durant le 1er siècle av. J.C., Lucrèce reviendra sur ce point : « La nature entière, telle qu’elle est, a donc une double origine ; elle comprend des corps et ce vide dans lequel ils se situent et se meuvent (De la nature, Livre I, 421). »
Eléments premiers constitutifs de la matière, les atomes sont donc doués de mouvement. Cependant, une question se pose : les atomes bénéficient-ils d’une liberté, même réduite, ou sont-ils totalement vassalisés par un strict déterminisme (doctrine selon laquelle le réel résulte de causes et d’effets nécessaires.) ? La question est d’importance car l’homme étant lui-même constitué d’atomes, en toute logique, sa liberté propre dépend de la leur. En outre, n’oublions pas que l’épicurisme est un strict matérialisme selon lequel la matière est la seule réalité. Par conséquent, il ne peut exister dans un tel système aucune explication qui ne soit matérielle. Impossible donc de recourir à un quelconque destin ou providence (à l’inverse des stoïciens) mais seulement à la nature avec laquelle Epicure nous invite à vivre le plus harmonieusement possible.
Avant de répondre à une telle question, il convient de s’en poser une autre : comment les corps se constituent-ils à partir des atomes ? En effet, nous dit Jean Brun (L’épicurisme P. 59), s’ils se comportaient comme : « des gouttes de pluie tombant de haut en bas à travers les profondeurs du vide ; entre eux nulle collision ne pourrait naître, nul choc se produire ; et jamais la nature n’eût rien créé... » Et, d’évidence, les atomes doivent bien pouvoir se rencontrer à un moment ou à un autre pour s’agglomérer car, comme nous venons de le voir, si leur course était parfaitement rectiligne ils ne pourraient jamais se rencontrer.
Alors, comment les choses se passent-elles ? Non seulement nous ne disposons d’aucun texte n’émanant de la main d’Epicure mais, de plus, certains spécialistes affirment qu’il n’a pas traité cette question alors que d’autres, au contraire, considèrent qu’il s’agit là : « d’une lacune probable dans les fragments d’Epicure (Jean Brun ibid p. 58) » (Je laisse au lecteur le soin de consulter l’ouvrage de Jean Brun qui comporte un long développement à ce sujet) Par contre nous disposons du beau texte de Lucrèce (ibid, Livre II, 217) dans lequel le poête-philosophe épicurien nous fait savoir que : « Les atomes descendent bien en droite ligne dans le vide, entraînés par leur pesanteur ; mais il leur arrive, on ne saurait dire où ni quand, de s’écarter un peu de la verticale, si peu qu’à peine peut-on parler de déclinaison. » Un peu plus loin, (ibid Livre II, 243), Lucrèce revient sur le sujet : « C’est pourquoi, je le répète, il faut que les atomes s’écartent un peu de la verticale, mais à peine et le moins possible. » Ce serait donc cette déclinaison (clinamen) qui, en provoquant des chocs entre atomes, serait à l’origine de la formation des corps comme, d’ailleurs, de leur désintégration.
Cette théorie de la déclinaison dépasse très largement le seul cadre de la physique car elle jette une passerelle entre cette notion et la liberté humaine. D’ailleurs, écoutons Lucrèce : « Mais il faut encore que l’esprit ne porte pas en soi une nécessité intérieure qui le contraigne dans tous ses actes, il faut qu’il échappe à cette tyrannie et ne se trouve pas réduit à la passivité : or, tel est l’effet d’une légère déviation des atomes, dans des lieux et des temps non-déterminés. (ibid, livre II, 291) » C’est pourquoi, remarque Graziano Arrighetti (in Encyclopédie de la pléiade, Vol 1, p. 759) : « Si l’on (l’épicurisme) en était resté à la conception de Démocrite, pour qui la seule détermination du mouvement atomique provenait des heurts entre atomes, c’est à dire d’une force extérieure, il aurait été impossible de soustraire les évènements du monde au principe de causalité nécessaire. Si Epicure voulait sauver la liberté, il se voyait forcé à admettre un principe causal qui ne présupposait que lui-même. C’est pourquoi il postula la déclinaison atomique (clinamen) ou possibilité, pour les atomes, d’échapper spontanément à leur mouvement naturel de chute vers le bas. »
La lecture attentive de cette citation fait clairement apparaître le rôle d’une physique, certes géniale d’autant plus qu’elle reposait sur des intuitions, mais dont la finalité concernait la condition humaine et non une recherche scientifique au sens moderne du terme. Ainsi donc, si la physique d’Epicure est une « physique simple, Michel Onfray, ibid p. 182 », elle n’en constitue pas moins une sorte de propédeutique (enseignement préparatoire destiné à préparer des études plus approfondies) à la liberté humaine acquise, dans un premier temps, grâce au déni des mythes et à celui des superstitions. L’univers étant non-créé, il obéit à ses propres lois qui ne sont en aucun cas supervisées par une quelconque divinité. Il s’agit, écrivit Léon Robin (La pensée grecque, P. 371) « d’un matérialisme, non pas vitaliste, mais mécaniste, celui de l’école d’Abdère (Leucippe, Démocrite). Rien ne vient du néant, car tout alors pourrait provenir de n’importe quoi ; rien ne s’anéantit non plus, car alors, depuis longtemps, il n’y aurait plus rien. La réalité est double : les corps et le vide. » Comme nous le voyons, pas de place pour un tiers qu’il soit divin ou non. Alors qu’en est-il des dieux ? Certes, nous dit Epicure (Lettre à Pythoclès Diogène Laërce, ibid p. 259) : « Les dieux existent, nous en avons une connaissance évidente. » Admettons... Mais pourquoi faire ? Ici encore, Epicure nous rassure : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde (...) » La première de ces deux citations nous interdit de considérer Epicure comme un athée (Négation de l’existence de Dieu ou des dieux) au sens strict du terme. Cependant, remarquons que pour un croyant la notion de divin a une utilité. Par exemple “le salut de l’âme” chez les chrétiens. Mais, chez Epicure, qu’elle est l’utilité de cette notion ? Il ne peut être qualifié d’agnostique (refus de se prononcer sur l’existence ou la non-existence de dieu) il ne peut, non plus, être considéré comme un déiste (Dieu existe hors des dogmes et d’un culte en tant que principe explicateur de l’univers - le « grand architecte » des “lumières” -). N’étant rien de tout cela, que peut-on dire de la conception du divin chez Epicure ? Reprenant une formule de Gilles Deleuze : « athéisme tranquille », Michel Onfray a sans doute apporté la meilleure réponse possible à cette question : « Dans le cas d’Epicure, contrairement à ce que les gardiens du temple universitaire enseignent, on pourrait parler d’un athéisme tranquille. (...) L’athéisme tranquille se moque de l’existence de(s) dieu (x) pourvu qu’eux-mêmes ne se soucient aucunement des hommes. Que le ciel soit vide ou non importe peu, si celui ou ceux qui l’habitent ne s’occupent pas des affaires humaines. C’est le cas d’Epicure, qui proposent des dieux tellement indolents qu’ils en deviennent saints pour l’athée (ibid p. 201). » Lucrèce, dont la lucidité en matière de divin est des plus salvatrice, a mis l’accent sur un lieu commun : l’injustice divine sur laquelle il me paraît des plus utile de réfléchir : « Pense-t-on que c’est Jupiter et les autres dieux qui ébranlent la voûte lumineuse du monde avec un bruit terrifiant (...) Alors pourquoi ne frappent-ils pas les mortels qui osent commettre des crimes odieux ? (...) Cela ferait pourtant un exemple redoutable pour les autres hommes. Pourquoi au contraire celui à qui sa conscience ne fait jamais honte se trouve-t-il enveloppé dans les flammes, tout innocent qu’il est, et pourquoi est-ce lui que le tourbillon céleste entraîne tout à coup, lui que le feu dévore ? (ibid, Livre VI, 387). »
Bien que mon “athéologisme” soit loin d’être “tranquille”, je ne peux que donner mon assentiment à une théologie aussi inoffensive. Rendez-vous compte ! Pas d’asservissement à un dieu plus sourcilleux qu’une faux ; pas de culpabilité dont l’origine remonterait à “l’âge d’or”. Non, en lieu et place de tout cela, la liberté face à la métaphysique nécrophage de l’Empyrée (lieu des bienheureux, dit-on...) ; le rire de Démocrite face aux mythes, fables et légendes dont l’unique vocation est d’embrumer la raison. Ne sommes-nous pas proches du rêve ?
Refermons cette parenthèse et revenons à Epicure. Nous venons de survoler sa physique laquelle, rappelons le, est l’une des bases de l’éthique donc, l’une des conditions de l’ataraxie. Seulement, pour parvenir à cette forme ultime du bonheur, l’élaboration d’une physique ne suffit pas. Il faut, en outre, connaître l’objet de cette physique, la nature, ne serait-ce que pour vivre en harmonie avec elle. Pour ce faire, nul besoin de texte sacré car, nous l’avons vu, les dieux ne s’occupent ni de l’univers ni des hommes. Inutile aussi la dialectique ascendante de Platon car la nature n’a pas de modèle tapis quelque part “en haut”. Alors, que reste-t-il pour connaître ? Tout simplement ce qui nous entoure. Et, comment perçoit-on ce qui nous entoure ? Grâce à nos sens donc, à nos sensations. Toute la théorie de la connaissance prônée par Epicure est ici résumée : « Toutes nos connaissances viennent en effet des sensations, soit par concomitance, soit par comparaison, soit par ressemblance, soit par synthèse. A elles se surajoute le raisonnement qui les élabore (Diogène Laërce, ibid p. 225). » Un peu plus loin (nous sommes toujours dans la lettre à Ménécée), Epicure ajoute : « Si vous rejetez toutes les sensations, vous n’aurez plus rien sur quoi vous appuyer pour dire que certaines d’entre-elles sont fausses, et pour discerner la vérité, (Diogène Laërce, ibid p. 267). »
Ces deux citations nous montrent clairement que l’épicurisme est un sensualisme intégral (doctrine selon laquelle les sensations sont à la base de toutes nos connaissances et de toutes nos idées.) Mais, et au-delà ce sensualisme, l’épicurisme est également un empirisme (doctrine selon laquelle la connaissance est fondée sur l’expérience sensible externe (sensations) et interne (nos sentiments tels qu’ils sont vécus). Pour Epicure, nous dit Jean Brun en citant Sextus Empiricus (ibid p. 32), « tout ce qui est perçu est vrai et réel, car il n’y a pas de différence entre dire que quelque chose est vrai et dire que cette chose existe... Vrai signifie donc ce qui est, comme il est dit être, faux ce qui n’est pas, comme il est dit non-être. » Nous mesurons ici la distance qui sépare Platon d’Epicure. Pour le premier, la connaissance du vrai ne pouvait s’acquérir qu’au terme d’une séparation avec le monde sensible (celui perçu par les sens) alors que, pour le second, cette même connaissance dépend d’une sorte de fusion entre l’homme avec ce même monde sensible.
Ceci étant, décréter que les sensations sont les outils même de la connaissance implique forcément qu’elles soient parfaitement fiables. Le sont-elles ? D’autre part, les connaissances qui en découlent (c’est à dire, le saisissement du vrai) le sont-elles aussi ? Il faut tout d’abord remarquer que pour Epicure : « La sensation est irrationnelle et étrangère à la mémoire, car, ni par elle-même ni par suite d’une impulsion étrangère, elle ne peut croître ni diminuer, et elle ne peut-être réfutée par aucun critère( Diogène Laërce, ibid p. 225). » Par “sensation irrationnelle”, il ne faut surtout pas penser que ce mode de préhension du réel serait fantaisiste, voire absurde. Cette formule veut simplement dire que la sensation est hors raison en n’oubliant pas, toutefois, que l’une n’exclut en rien l’autre. A priori, donc, les sensations apparaissent fiables. Penser cela reviendrait à méconnaître Epicure pour lequel la connaissance naît des interprétations effectuées par la raison qui, par-là même, suggère des hypothèses. Seulement parmi les hypothèses il en est une que les épicuriens qualifient “d’opinion”. En clair, une opinion est une hypothèse susceptible d’être vrai ou fausse. Pour illustrer ce relativisme, Diogène Laërce (ibid. p. 226) évoque une tour aperçue de loin : « Il faut suspendre son jugement, nous dit-il, et attendre d’être près de la tour pour voir si de près elle est semblable à ce qu’elle paraissait être de loin. » Cette anecdote dévoile un aspect très important de la théorie de la connaissance développée par Epicure. Pour lui, en effet, il faut se garder d’assigner une cause unique à un phénomène donné. Allant bien plus loin encore, il affirme qu’il s’agit là de l’une des conditions permettant de goûter à l’ataraxie : « Or nous obtenons en tout la fixité et la tranquillité (l’ataraxie), en expliquant toutes choses par plusieurs hypothèses toutes d’accord avec les phénomènes, sans rien rejeter de tout ce qui peut être dit sur eux de plausible (Diogène Laërce, ibid p. 245) » Il s’agit bien d’une forme de relativisme (doctrine selon laquelle la vérité est relative aux individus – que l’on se souvienne du sophiste Protagoras évoqué dans mon précédent article -). D’ailleurs, Epicure consolide ce point de vue : « Il n’y a, d’autre part, rien qui s’y oppose (sur l’origine de la lumière perçue sur terre) dans les phénomènes météorologiques, si l’on se souvient bien que tout phénomène admet des explications multiples, et si l’on considère à la fois les hypothèses et les causes qui lui conviennent, en évitant bien de s’attarder à celles qui ne lui conviennent pas, crainte de tomber d’une façon ou d’une autre dans une explication unique (Diogène Laërce, ibid p. 249). » Cette méthode des explications multiples ne peut que conduire à un rejet du dogmatisme (doctrine affirmant que l’on peut atteindre puis démontrer des vérités certaines ou même absolues) et à la négation de toute idée de cause finale. Ajoutons à cela la totale indifférence de dieux vivant à l’intérieur d’intermondes inaccessibles à l’humain, Epicure donne à l’homme la possibilité d’être libre et, peut-être d’être heureux. Il n’a pas véritablement ce que l’on appelle “un esprit scientifique” mais qu’elle importance puisque sa physique n’a d’autre but que d’apporter aux hommes des matériaux susceptibles d’apaiser leurs âmes. Epicure est un pragmatique (ce mot est entendu ici dans son acception ordinaire). Il n’a pas besoin d’une cause première ; inutile pour lui de disposer d’un creuset duquel aurait jailli le “tout”. D’ailleurs, le tout, il s’en moque comme de l’origine des atomes ou, encore, de l’instabilité des phénomènes. Ils existent, nous en avons l’expérience sensible, que rajouter d’autre ? Et, surtout, pourquoi faudrait-il s’en étonner ?
Bien évidemment, la physique d’Epicure et la théorie de la connaissance qui l’accompagne ne se borne pas à ces quelques pages. Par exemple, il faudrait étudier les “prolepses” (sorte d’idées générales qui sont formées en nous à la suite d’innombrables perceptions d’un même objet (Graziano Arrighetti, ibid. p. 755). Pour nous, modernes, une prolepse est donc la représentation mentale (l’image) d’un objet donné. C’est précisément cette notion de prolepse qui amena Epicure à affirmer que les dieux existaient (Cf. supra). « La première preuve de l’existence des dieux, nous dit Graziano Arrighetti, ibid. p. 763, Epicure la tirait d’une constatation de fait. L’homme porte en lui la prolepse d’êtres heureux et immortels. Or, selon les principes de la gnoséologie (théorie philosophique de la connaissance), il ne peut exister de prolepses de ce qui n’existe pas. Donc, les dieux doivent exister. » On ne peut s’empêcher de songer à l’innéisme des idées de Descartes (doctrine selon laquelle il existe des idées innées.) Pour Descartes (1591/1650), en effet, l’idée de parfait qui est en nous (alors que nous savons être imparfaits) est une preuve de l’existence de dieu. Cette thèse repose sur l’idée qu’un être imparfait (l’homme) ne peut concevoir par lui-même l’idée du parfait. Pour un philosophe comme Descartes, cette idée du parfait ne peut provenir que d’un être parfait par conséquent, en aucun cas de nous-mêmes. Il n’est pas possible ici de montrer que nous sommes face à un quasi-sophisme. Toutefois, nous pouvons noter que cette conception nous renvoie au dualisme inné/acquis. L’inné relevant de nos gènes et l’acquis de notre culture. Par exemple, notre morphologie (forme et structure des êtres vivants) appartient à la partie innée de nous-même alors que beaucoup de nos comportements (je n’ai pas dis la totalité) nous sont dictés par l’acquis (éducation, environnement social etc..) Ceci posé, la comparaison entre la prolepse épicurienne et l’innéisme des idées de Descartes s’arrête là. En effet, et contrairement à l’épicurisme, le cartésianisme est un dualisme selon lequel l’âme et le corps sont deux substances totalement différentes. La première est immatérielle alors que la seconde est une pure étendue géométrique (attribut essentiel de la matière). Alors que, rappelons le, l’âme et le corps épicuriens sont tous deux constitués d’atomes donc de matière.
Il est sans doute important de noter que la prolepse est très proche de ce que nous nommons : un concept (si l’on se réfère à son acception la plus élémentaire, un concept est une idée, une abstraction, un objet conçu par l’esprit ou acquis par lui, et permettant d’organiser les perceptions et les connaissances – Larousse -). Alors, qu’était un concept pour les épicuriens ? « Le concept, nous dit Diogène Laërce, (ibid. p. 225), est quelque chose comme une vue d’ensemble, une opinion droite, une réflexion, une intellection immédiate, innée, comme l’image du sensible survivant dans la mémoire (...) Donc, ce qu’exprime un nom est une notion claire, car nous ne demanderions pas ce que nous demandons, si nous ne connaissions pas d’abord le sens du mot qui entre dans notre question, par exemple : « Ce qui est là-bas, est-ce un bœuf ou un cheval ? » suppose qu’on connaît la forme du cheval et du bœuf, images qui forment les concepts. » Cette citation est d’autant plus intéressante qu’elle est toujours d’actualité. En effet, que signifie connaître sinon accumuler des images mentales allant des plus objectives (l’image d’un cheval, par exemple) au plus abstraites (un algorithme). Si l’on veut bien réfléchir à cela, on comprendra aisément que les mots constituent une base de données dont l’ampleur détermine le niveau de nos connaissances. Bien que la vocation de cet article ne consiste en aucun cas à prodiguer des conseils au lecteur, je vais malgré tout en donner un à l’attention des jeunes : ne soyez pas obsédés par les mathématiques, la physique ou la chimie ! Ces disciplines, certes indispensables, sont finalement de peu d’utilité en matière existentielle et sont bien vaines, le plus souvent, en matière de bonheur. Par contre, la maîtrise des mots est une boussole orientant les pas dans la vie. Et, souvenez-vous des paroles d’Epicure : « Quand on n’est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. » Car, philosopher n’est pas errer au gré de phantasmes plus ou moins intellectualisés, non, philosopher signifie tout simplement comprendre et donc : penser et, au-delà encore : vivre.
Outre les prolepses, nous devrions aussi nous intéresser aux “simulacres” (sortes d’émanations provenant des corps et parvenant jusqu’à nos sens) lesquels, pour les épicuriens sont les véritables outils de la connaissance. De même, il n’existe pas un seul type de sensations mais au moins deux : « les sensations communes s’il s’agit d’un objet commun, les sensations particulières, s’il s’agit d’un objet particulier, Diogène Laërce, ibid. p. 243) ». Cependant, approfondir ces sujets n’apporterait rien de plus à notre propos qui consiste à comprendre comment l’éthique épicurienne a pu s’élaborer à partir d’une physique douée d’une remarquable efficacité. En effet, et je le rappelle, son importance est capitale dans la mesure ou elle interdit toute métaphysique : pas de transcendance, pas d’efficience du divin, pas de distinction platonicienne entre “intelligible” et “monde sensible” (donc pas de lecture “verticale” du monde). Conséquemment, pas de place ni de rôle pour les dieux, qu’ils existent ou non, qu’ils soient “architectes” ou régisseurs de l’univers ou non. La philosophie épicurienne (ou la sagesse, selon certains) est une porte largement ouverte sur une liberté devant favoriser la recherche du bonheur.
Par conséquent, si, pour Epicure, il faut philosopher, ce n’est pas uniquement dans le but de connaître. Pour lui, il existe une autre finalité qui n’a pas échappé à Michel Onfray : « Bien avant Nietzsche, qui expérimente et théorise cette évidence dans la préface au “gai savoir”, Epicure affirme qu’on philosophe avec un corps et qu’on ne devient pas sage à partir de n’importe quel état corporel. Une physiologie de la philosophie, en plein IVe siècle avant notre ère, voila un trait de génie remarquable – un de plus – de la part d’un philosophe qui parvient à cristalliser seul une pensée qui (...) pèse d’un poids considérable en matière de résistance au régime d’écriture platonicien, chrétien et idéaliste de la philosophie occidentale. Voila un corps glorieux, au sens païen du terme ! )Les sagesses antiques p. 181). »
Une “physiologie de la philosophie”, nous dit Michel Onfray qui surenchérit un peu plus loin (p. 193) : « Le premier, il semble inventer cette philosophie exclusivement entendue comme une médecine, une thérapie de l’âme et du corps. » Si l’on veut bien suivre Michel Onfray, la philosophie d’Epicure se présenterait donc sous la forme d’une thérapie chargée de soigner (de guérir, si possible) les blessures de l’âme. Et, en tout dernier lieu, de préserver cette âme des inévitables désagréments qui la menacent toujours. Si l’on y réfléchit bien, cela voudrait dire que l’âme est structurellement “malade” et donc, que le bonheur est inaccessible puisqu’il ne peut s’accommoder de la souffrance. Alors, pourquoi cet acharnement à le rechercher ? Ici, nous entrons au cœur de l’éthique épicurienne. Non, nous dit Epicure, le bonheur n’est pas inaccessible à la condition, toutefois, « d’étudier les moyens de l’acquérir puisque quand il est là nous avons tout, et quand il n’est pas là, nous faisons tout pour l’acquérir,( Diogène Laërce, ibid. p. 258). » Le bonheur n’est donc pas un état permanent qui baignerait l’homme durant toute sa vie. Bien au contraire, si l’homme peut être heureux, il peut tout aussi bien ne pas l’être et l’expérience montre que c’est très souvent le cas. Epicure fut très bien placé pour savoir cela lui qui souffrit durant quasiment toute sa vie en raison d’une santé des plus chancelante. Aussi n’est-il pas surprenant qu’Epicure définisse le plaisir en tant qu’absence de déplaisir donc, de souffrance. De fait, ne pas souffrir encourage un état de plénitude qui s’apparente à une certaine forme de bonheur. Mais, pour pouvoir éprouver cela, il faut au préalable avoir ressenti, dans sa chair ou son âme, ce que l’on nomme : souffrance.
Si donc, le plaisir est dans un premier temps une absence de déplaisir, on concevra aisément que la première manifestation du bonheur (l’ataraxie) consiste dans l’absence de trouble de l’âme. En effet, comment une âme troublée (par un deuil, par exemple) pourrait-elle accéder à la plénitude ? Comment une âme terrifiée par des dieux capricieux et vengeurs pourrait-elle éprouver ne serait-ce qu’un début de sérénité ? Chez Epicure, l’ataraxie débute donc par une négativité c’est à dire par une “absence” et non par une “présence”. « Epicure, nous dit Michel Onfray (Ibid. p. 212), met tout en oeuvre pour travailler à l’évitement du déplaisir et crée le plaisir dans et par cet évitement. Les dieux ? la mort ? la crainte, la maladie ? la souffrance ? l’angoisse ? autant de variations sur une négativité à détruire. » Condition sine qua non du bonheur, le plaisir, ne serait-il que cela ? Une simple absence de déplaisir donc de trouble ? Certes non car l’homme est avant désir ! Et pourquoi ? Parce qu’il est structurellement manque ! « Nous recherchons le plaisir, nous dit Epicure, seulement quand son absence nous cause une souffrance. Quand nous ne souffrons pas, nous n’avons plus que faire du plaisir,( Diogène Laërce, ibid. p. 261). » Certes ! L’absence de souffrance rend le plaisir inutile ! Seulement, pour parvenir à cet état de “non-ressenti” ne faudrait-il pas que le corps renonce à ses désirs ? Car, à peine un désir est-il satisfait qu’un autre surgit avec une identique véhémence. Par exemple, nous avons faim (et que l’on soit philosophe ou non, cela peut arriver.. !) La faim est un manque et un manque qui exige sa suppression. Pour ce faire, nous allons donc manger ce qui va nous procurer un plaisir. Enfin rassasiés, le désir de manger et l’attente du plaisir qui l’accompagne sont, de fait, devenus, l’un et l’autre, inutiles. Tout serait parfait si les choses en restaient ainsi. Seulement, manger induit le besoin de boire ce qui enclenche un nouveau cycle manque/désir/plaisir. Alors, le bonheur conçu comme une absence de trouble de l’âme c’est à dire, une absence de ressenti, serait-il une erreur ? Une utopie ? Serait-il en totale contradiction avec la vie ? Epicure se serait-il égaré dans un idéal de plénitude inaccessible ? On serait fondé à le penser si Epicure n’avait prit la précaution de distinguer deux sortes de plaisirs : les plaisirs “en repos” et les plaisirs “en mouvement”. « Epicure est en désaccord avec les cyrénaïques, sur la théorie du plaisir, nous dit Diogène Laërce, (ibid. p. 263). Ceux-ci mettent le plaisir, non dans le repos, mais dans le mouvement. Epicure accepte les deux, qu’il s’agisse de l’âme ou du corps.(...) Le plaisir, c’est ce qui est en repos, et ce qui est en mouvement. Et Epicure dit dans le livre du choix : L’ataraxie, l’absence de douleur sont des plaisirs en repos, la joie et l’allégresse sont des plaisirs en mouvement. » Ici nous sommes parvenus au cœur de la notion d’ataraxie chez Epicure. Cette ataraxie n’est pas une utopie mais, par contre, elle ne peut prétendre perdurer toujours. Tout comme le bonheur, elle est constituée d’instants de non-désir donc, de non-manque. Elle est une sorte d’état neutre durant lequel le corps est en repos. Elle est, effectivement, une absence de trouble, une absence de désir, un plaisir en repos. Oui, mais jusqu’à ce qu’un nouveau désir jaillisse qu’il faudra bien satisfaire par une action, par un plaisir en mouvement.
Bien qu’Epicure ne l’ait pas formulée ainsi, il existe un antagonisme entre plaisir en repos et plaisir en mouvement, le premier étant sous la dépendance du second (d’ou sa divergence avec les cyrénaïques.) Plus encore, l’absence de trouble ne peut survenir si un seul désir n’est pas comblé car, nous dirait un freudien, un désir non-comblé se transforme en une douloureuse frustration. Sans doute, Epicure eut-il l’intuition de cette mécanique infernale. En effet, et comme nous l’avons déjà noté, il nous fait savoir qu’il existe plusieurs sortes de désirs : « Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires (ceux-ci préservent de la douleur. Par exemple, manger quand on a faim), les autres naturels et non-nécessaires (Ceux là ne sont que des “envies” comme celle de boire du bon vin), et les autres, ni naturels ni nécessaires, mais l’effet d’opinions creuses.(Diogène Laërce, ibid. p. 268) » (Ces derniers sont les pires : goût des “titres”, des “honneurs”, de la notoriété, de “l’argent” etc..) Ici, je ne peux m’empêcher de penser à l’utilitarisme de Jeremy Bentham (1748/1832) et surtout à celui de John Stuart Mill (1806/1873). Pour note, l’utilitarisme est une doctrine selon laquelle le but de la société doit être la recherche du bonheur pour le plus grand nombre. De la sorte, ce type de société correspond à la somme des plaisirs ressentis par chaque individu. A la suite d’Epicure, Mill nous fait savoir que les plaisirs qui constituent le bonheur des hommes doivent être soumis à une appréciation qualitative et non pas uniquement quantitative comme le pensait Bentham. Peut-être pouvons-nous établir une filiation (non revendiquée, à ma connaissance) entre la conception cyrénaïque des plaisirs avec celle de Bentham et une autre entre la conception épicurienne et celle de Mill.
Ecrite, il y a vingt-trois siècles, la remarquable mensuration comparative d’Epicure (Léon Robin, ibid. p. 379) reste tout à fait d’actualité. Que l’on songe, en effet, à la publicité dont la vocation consiste à susciter toujours plus de désirs aussi inutiles que néfastes. L’exposition privilégiée de certains produits dans les grandes surfaces ; le dernier “portable” à la mode sans lequel, bien évidemment, il ne serait plus possible de vivre ; le cosmétique miraculeux qui, n’en doutons pas, va occulter les marques d’un temps qui, désormais, n’existe plus. Ajoutons à cela le “gavage” (désolé, il n’y a pas d’autre mot) des enfants qui croulent sous des montagnes d’objets qui, dans le meilleur des cas, illuminent leurs visages durant quelques secondes. Et puis, on s’étonne : ils sont capricieux ! Mais, le caprice n’est-il pas un désir dépourvu de cible ? Alors, cher Epicure, des désirs ni naturels, ni nécessaires... ?
L’ataraxie est bien une forme d’eudémonisme (le bonheur est le souverain bien ; le souverain bien étant le meilleur bien possible dont un homme puisse jouir). Seulement, et nous venons de le voir, l’eudémonisme n’est rien sans une composante hédoniste (pour cette doctrine, le plaisir est le souverain bien, rappelons le) laquelle, pour Epicure, doit être judicieusement dosée : « Par conséquent, nous dit-il, lorsque nous disons que le plaisir est le souverain bien, nous ne parlons des plaisirs des débauchés, ni des jouissances sensuelles, comme le prétendent quelques ignorants qui nous combattent et défigurent notre pensée... (Diogène Laërce, ibid. p. 262). » Contrairement à l’affirmation de Cicéron selon laquelle : « Toutes les prescriptions d’Epicure sur le plaisir amènent à cette règle qu’il faut toujours souhaiter et rechercher le plaisir pour lui-même(...) (Le bonheur dépend de l’âme seule, p. 78) », Epicure ne fait pas du plaisir une fin en soi (attitude que l’on prête – à tord, peut-être - aux cyrénaïques) mais seulement un moyen d’atteindre (enfin) la paix de l’âme. L’hédonisme d’Epicure est, comme nous le précise Michel Onfray (ibid. p. 190 et suiv.), « un hédonisme ascétique » qui repose essentiellement sur le refus de la douleur. Ceci posé, on peut mieux comprendre la classification des désirs dont nous parle Epicure. En effet, ceux-ci (entendus comme moteurs des plaisirs) peuvent être nocifs : « Aucun plaisir n’est de soi un mal, mais les effets de certains plaisirs apportent avec eux de nombreux troubles plus intenses que les plaisirs qui les ont causés,( Diogène Laërce, Ibid. p. 265). » Aussi, est-il sage de bien juger les désirs qui se propagent en nous afin de se préserver des désagréments causés par certains. Il faut, nous dit Michel Onfray, (ibid. p. 208), : « connaître la logique des désirs naturels et nécessaires. Connaître la logique des désirs auxquels on a affaire, les reconnaître dans leur diversité confuse et mélangée, savoir comment y répondre, les éviter, ne rien ignorer des conséquences d’une satisfaction ou d’un refus de satisfaire, voila autant d’opérations qui permettent d’accéder à la vérité hédoniste. »
Ici, nous retrouvons la théorie de la connaissance promulguée par Epicure. Les sensations (les plaisirs en font partie) sont à la base de la connaissance sensorielle mais aussi de la connaissance intellectuelle. C’est la raison qui juge. C’est elle qui, in fine, opère le tri entre ce qui est bon et mauvais pour l’homme (et non, notez-le, ce qui est bien ou mal). Nulle trace de morale (notamment d’origine chrétienne) chez Epicure mais une sagesse uniquement préoccupée par le bonheur de l’homme. L’hédonisme d’Épicure est dual, antithétique et, quelque part, un peu parménidien : si a est nocif pour l’homme, il faut impérativement le remplacer par non-a. De toute manière, les deux ne peuvent cohabiter comme le plaisir et la souffrance ne peuvent s’accommoder l’un de l’autre. Si certains désirs sont inassouvissables, il faut les fuir, les rejeter, les bannir de notre vie. Il faut, nous dit Epicure, « Ne dépendre que de soi-même (...) mais il ne s’ensuit pas qu’il faille toujours se contenter de peu. Simplement, quand l’abondance nous fait défaut, nous devons pouvoir, nous contenter de peu, étant bien persuadés que ceux-là jouissent le mieux de la richesse qui en ont le moins besoin, et que tout ce qui est naturel s’obtient aisément, tandis que ce qui ne l’est pas s’obtient malaisément. Les mets les plus simples apportent autant de plaisir que la table la plus richement servie, quand est absente la souffrance que cause le besoin (...), (Diogène Laërce, ibid. p. 261). » Il faut donc apprendre “à vivre selon ses moyens” pourrait-on dire aujourd’hui et, surtout, ne pas envier ceux qui en ont davantage car ce surcroît n’est aucunement garant du bonheur.
Loin d’être universelle, l’éthique épicurienne est avant tout individualiste. Elle ne délivre pas un message politique, elle ne cherche pas (à l’inverse de Platon) à construire une cité idéale. Elle ne s’embourbe pas non plus dans les détestables notions de “bien” et de “mal”. Et, bien qu’Epicure ne puisse être considéré comme un athée, son éthique peut être assimilée à un pré-humanisme dans la mesure ou l’homme est au centre de sa philosophie. Mais, l’homme d’Epicure est avant tout un corps qui doit être écouté et préservé de tout ce qui pourrait lui nuire. Si le plaisir n’est pas dénié, il doit cependant être raisonnable et toujours ressenti à bon escient. Pour Epicure, le bonheur est sur terre, ici et maintenant. L’âme n’a rien à attendre d’un présupposé au-delà puisque, la mort venue, elle se désagrège tout comme le corps. Cette mort, d’ailleurs, n’a que peu d’importance car, nous dit Epicure (Diogène Laërce, ibid, p. 259) « Elle n’est rien pour nous, puisque tant que nous vivons, la mort n’existe pas. Et lorsque la mort est là, alors, nous ne sommes plus. » L’épicurisme est un hymne à la vie du corps et de l’esprit réunis par une sorte de fraternité atomique. En matière de connaissance, il n’existe pas de vérité absolue par conséquent, l’épicurisme est un anti-dogmatisme. La paix de l’âme peut s’obtenir en dehors de toute certitude. Cette âme n’éprouve pas le besoin de l’éternité ; elle est là et cela est largement suffisant. Alors, peut-on se demander, pourquoi une aussi sage, une aussi belle philosophie a-t-elle été à ce point vilipendée ? Pourquoi le stoïcien Epictète qualifia-t-il Epicure "d’amoral?" Pourquoi Timocrate, pourtant un ancien élève d’Epicure, déclara que ce dernier « vomissait deux fois par jour tant il mangeait » alors que le fondateur de l’épicurisme était réputé pour sa frugalité ? Pourquoi le sceptique Timon (3è siècle av. J.C.) le traita-t-il de “porc”, image dégradante qui fut promulguée par Horace (1er siècle av. J.C.) notamment dans son quatrième épître ? Pourquoi encore Epicure et l’épicurisme suscitèrent tant de haine ? Et surtout comment se fait-il, qu’aujourd’hui encore, un épicurien soit assimilé à « une personne qui professe une morale facile, qui recherche en tout son plaisir ou de ce qui se rapporte à cette tendance morale. Dictionnaire Larousse, 1993 » ?
Une nouvelle fois, Michel Onfray, qui n’a de cesse de dénoncer la nocivité existentielle du platonisme, du stoïcisme et du christianisme (je partage pleinement son avis), apporte une réponse tout à fait moderne à ces questions : « La mauvaise réputation d’Epicure renseigne moins sur la véritable nature de la philosophie du Jardin que sur l’inhibition, les complexes et la misère corporelle de ses adversaires : platoniciens et stoïciens en ligne de front, suivis pas les chrétiens, ont considérablement révélé à leur insu l’insatisfaction dans laquelle ils étaient à l’endroit de leur chair, qu’ils aient eu besoin à ce point de la détester, de la meurtrir, de la haïr... L’antihédonisme révèle symptomatiquement la haine de soi, (ibid., p. 211). » Pour ces contempteurs du corps, l’hédonisme épicurien (comme celui des cyrénaïques) ne pouvait qu’être un encouragement à la débauche, qu’un déni opposé à une morale liberticide et asservissante. Finalement, ce que l’on appelle la “transcendance” s’accommode fort mal du corps qui lui relève de l’immanence c’est à dire d’une synergie entre le vivant et son cadre : la nature. L’épicurisme ne spécule pas sur l’imaginaire. Il propose tout simplement un certain nombre de règles simples lesquelles ont pour vocation de rendre l’homme plus heureux là où il est. En une phrase, quel est le message de l’épicurisme ? C’est beau d’être en vie... Ici et maintenant...
L’ATARAXIE DES STOICIENS : UNE SOUMISSION A L’UNIVERS ?

Comme nous l’avons remarqué dans le chapitre concernant les stoïciens (cf. mon article sur le logos), la richesse et la complexité de ce courant philosophique reposent d’une part sur sa durée (3e siècle av. J.C./2e siècle de notre ère) et sur sa division en trois périodes : 1) L’ancien stoïcisme dont Zénon de Cittium (336/264 av. J.C.), Cléanthe (331/232 av. J.C.) et Chrysippe (283/210 av. J.C.) furent les pères fondateurs. 2) Le stoïcisme moyen dont les penseurs principaux furent Panétius (185/112 av. J.C.) et Posidonius (135/51 av. J.C.). 3) Le stoïcisme dit “impérial” dont les trois principaux représentants furent : Sénèque (4 av. J.C./65 après J.C.), Epictète (50/130) et l’empereur romain Marc Aurèle (121/180). Toutefois, je me dois de nuancer quelque peu un avis émis dans mon précédent article. En effet, il est très excessif de considérer chacune de ces périodes comme une étape distinctive de la précédente. Cette erreur, commise semble-t-il par des historiens comme A. Schmekel ou K. Reinhardt, est sensiblement corrigée par la pensée contemporaine qui met l’accent sur l’homogénéité de l’école stoïcienne en dépit de son découpage en trois époques. Si donc, il existe une continuité philosophique dans le stoïcisme par contre, il est difficilement contestable que le stoïcisme impérial ait privilégié l’éthique, non au détriment de la physique ou de la logique, mais à partir de l’acquis de ces dernières. C’est ainsi que reprocher à Sénèque de ne point être un “vrai philosophe” mais seulement un moraliste uniquement préoccupé par des problèmes liés à l’éthique revient à méconnaître les liens très étroits existant entre la physique et l’éthique. En effet, nous fait savoir Jean Brun : « Pour les Stoïciens la physique est une morale et un mode de vie fondée en raison, la physique est sagesse et non pas un moyen de parvenir à elle (Le stoïcisme, p. 99). » Ainsi, pour un stoïcien (comme pour un épicurien), connaître la nature (but de la physique) équivaut à vivre selon la nature : « La raison, nous dit Diogène Laërce (ibid. p. 80), a été donnée aux animaux raisonnables d’une façon plus parfaite, vivre selon la nature devient pour eux vivre selon la raison (...) C’est pourquoi Zénon le premier (...) a dit que la fin était de vivre conformément à la nature, c’est à dire, à la vertu, car la nature nous conduit à la vertu. » Donc, et de l’aveu même de Zénon (le fondateur de l’école stoïcienne, rappelons le), il existe une fusion entre l’homme et la nature. D’ailleurs, peut-on s’en étonner lorsque l’on sait que le monde des stoïciens est gouverné par un esprit (dieu) qui se répand à travers la totalité du monde et que l’âme est une partie de l’esprit divin plongé dans le corps humain. Ce panthéisme (doctrine selon laquelle tout ce qui existe est en dieu, est dieu) constitue le fondement même de la doctrine stoïcienne dont la finalité est d’accorder ses conduites en fonction de cette conception.
Dès à présent il apparaît que l’acquisition du bonheur dépend de la relation établie entre l’homme et la nature : « Délibère avec la nature » conseille Sénèque dans la lettre No 3 adressée à Lucilius. « Pour moi, qu’est-ce que je veux ? S’interroge Epictète, Connaître la nature et la suivre. (Manuel, p. 206). » Sénèque, encore, précise que « La nature concilie l’homme avec l’homme (lettre à Lucilius No 9). » Bien que le thème de cette dernière lettre soit l’amitié, il est possible, sans trop trahir la pensée de Sénèque, de compléter la citation en ajoutant que la nature concilie également l’homme avec lui-même. D’ailleurs, Sénèque (à la suite de Panétius, il est vrai) infléchit le précepte de Zénon (“Il faut vivre conformément à la nature”) en indiquant à Lucilius (lettre No 20) que « La philosophie enseigne à faire, non à dire, et elle exige que chacun vive selon sa loi (que l’on peut traduire par : vivre selon sa nature). » Un raccourci trop rapide pourrait laisser penser que Sénèque rejoint ici le sophiste Protagoras pour lequel “l’homme est la mesure de toutes choses” (Cf. mon article sur le logos). Cependant, établir une telle relation reviendrait à oublier que “vivre selon sa nature” signifie toujours “vivre selon la nature” puisque la nature propre de l’homme se confond avec la nature en général. On ne peut en effet comprendre la doctrine stoïcienne si l’on oublie, ne serait-ce qu’un seul instant, que “Tout est dans tout” (Sénèque) et que, par conséquent, le général est imbriqué dans le particulier et inversement.
Si donc l’acquisition du bonheur dépend d’une vie conforme à la nature, il devient indispensable de la bien connaître et cette obligation implique la maîtrise d’une physique la plus opérante possible. Mais, avant toute chose, il convient de rappeler que la physique des grecs de l’Antiquité n’a strictement rien à voir avec son acception moderne. Pour nous, en effet, la physique concerne des relations quantitatives, mesurables. « La physique moderne, nous dit Jean Brun, est née du jour où, avec Galilée et Descartes, elle a été mathématisée (L’épicurisme, p. 41). » Si l’on excepte l’épicurisme (pour lequel la nature est un donné qui ne relève d’aucune intervention divine), la nature des grecs de l’Antiquité (et, a fortiori, celle des stoïciens) est un organisme vivant qui, en totalité, repose sur l’existence de dieux qu’ils soient architectes de l’univers ou non. Le monde des stoïciens est entièrement constitué de corps y compris les âmes ou même les dieux ou le dieu. (Cf. mon précédent article) Toutefois, et à l’inverse de Démocrite et des épicuriens selon lesquels les corps étaient constitués d’atomes, les stoïciens ne se sont pas posé ce genre de question. En effet, leur réalisme (doctrine selon laquelle il existe une réalité siégeant hors de la pensée) les a dissuadés d’aller plus loin. Pour eux, si les corps existent, puisqu’ils sont perceptibles par les sens, il est vain de se demander d’où ils proviennent et il suffit d’affirmer que “tout est corps” alors que pour les épicuriens, “tout est atomes”. Contrairement à ces derniers, les stoïciens ont affirmé que dans le monde : « Il n’y a pas de vide, toutes ses parties sont intimement liées par suite de l’harmonie et de l’accord entre les choses célestes et celles de la terre (Diogène Laërce, ibid. p. 97. » Par contre, à l’extérieur de ce monde : « est versé tout autour un vide illimité qui est incorporel (Diogène Laërce, ibid. p. 97. » Toutefois, et en dépit de ce matérialisme intégral (tout est corps donc, tout est matière), les stoïciens ont introduit dans leur système la notion “d’incorporels”. Dépourvues de matière, ces incorporels sont au nombre de quatre : L’exprimable, le vide, le lieu et le temps. Bien que cet aspect de la doctrine stoïcienne n’entre pas dans le cadre de cet article, il me paraît utile de nous arrêter quelques instants sur la notion d’exprimable en raison, notamment, de sa relation avec la théorie saussurienne du signe (Cf. Cours de linguistique générale. F. de Saussure). Pour les stoïciens, l’exprimable constitue la base du langage. En véritables précurseurs de Saussure, ils ont considéré que la parole (entendue comme échange d’informations) était constituée de trois éléments : 1) ce qui signifie ou le son de la voix perçue par l’oreille (le signifiant ou “l’image acoustique” de Saussure), 2) ce qui est signifié ou le sens du mot prononcé, 3) l’objet dont on parle ou le référent. Par exemple lorsque je dis “Laurent”, je prononce deux phonèmes : “Lau” et “rent” ; il s’agit du signifiant. Ces deux phonèmes génèrent une représentation mentale (un concept) ; il s’agit du signifié. Pour finir, l’homme nommé Laurent est l’objet (ou le référent) que je viens de désigner. Pour les stoïciens, le signifiant et l’objet désigné sont des corps. Par contre, le signifié (le sens du mot) est un incorporel.
Le monde des stoïciens est donc composé de corps et de quatre incorporels. Mais, et au-delà de cette conception purement matérialiste, ce monde est également composé de deux principes : « Le monde entier vient de deux principes, nous dit Diogène Laërce, le principe actif et le principe passif. Le principe passif est la matière inerte et sans qualité, le principe actif est la raison qui agit en elle, c’est à dire la divinité. (ibid. p. 95). » Cette conception du monde à partir de ces deux principes nous introduit au cœur du panthéisme des stoïciens (le panthéisme est la doctrine selon laquelle il existe une fusion du monde et de dieu. Il s’agit donc d’une immanence (il n’existe pas d’instance divine supérieure ou extérieur au monde). Le monde est donc constitué de matière et de divinité.) Dès lors, il devient compréhensible que vivre selon la nature revient à vivre conformément à la raison divine qui, elle seule, est responsable de l’ordre des choses. Seulement, s’il existe une raison divine supposée régir le monde, ce même monde est sous l’égide d’un déterminisme absolu (imposé par la divinité) ne laissant quasiment aucune place à la liberté humaine. C’est dans ce cadre, somme toute des plus rigide, que s’inscrivent les notions de destin et de providence.
Le destin des stoïciens ne correspond en rien à son acception moderne. En effet, il ne s’agit pas de revers subis en raison d’une infortune plus ou moins pugnace mais d’une loi quasiment rationnelle chargée de régler les causes étant à l’origine des évènements. Vu sous cet angle, le destin s’apparente à une sorte d’intermédiaire entre les deux principes passif et actif. Il serait donc le maître d’œuvre de tout ce qui se passe dans la matière et, par conséquent, nul ne pourrait y échapper. Cette conception, pour le moins réductrice, fut tout naturellement combattue par Epicure. Ce point de divergence s’explique si l’on veut bien se souvenir que, pour le philosophe du jardin, certes les dieux existaient mais ne jouaient aucun rôle dans les affaires du monde. Dès lors, “le sage épicurien ne pouvait que rire” du destin des stoïciens.
De son coté, la providence des stoïciens ne peut être assimilée à une sorte de “bienveillance divine” envers les créatures du monde. Selon leur doctrine, la providence exprime une nécessité, celle dont dépend l’existence même des choses : « La providence, nous dit Jean Brun, (ibid. p. 80) a organisé toutes choses selon les lois inexorables du destin, vivre en accord avec la nature n’est-ce pas dès lors se laisser aller au déterminisme des lois qui nous entraînent malgré nous ? » Nous voyons ici combien destin et providence sont liés et sont à l’origine d’un déterminisme finaliste des plus rigoureux. « Tout est soumis au destin. Nous dit Diogène Laërce (ibid. p. 100 et 101). Ils (les stoïciens) définissent le destin : l’enchaînement des causes des choses, ou encore la raison qui gouverne le monde (le logos). Au-dessus de tout il y a une divinité, sinon même une providence. Ils la définissent un art qui se réalise en actes. »
Une question semble s’imposer : pourquoi les stoïciens et les épicuriens se sont-ils systématiquement opposés alors que leurs écoles reposaient sur un principe identique : Vivre en accord avec la nature ? Cette question est d’autant plus intéressante qu’elle en sous-tend une autre qui concerne, cette fois-ci, la conception que l’homme se fait du divin. En effet, au-delà les divergences de forme, l’affrontement entre stoïcisme et épicurisme repose sur l’opposition entre le panthéisme des premiers et “l’athéisme tranquille” des seconds (Cf. Supra). Il faut bien comprendre que l’attribution à un dieu (ou a des dieux) de la gestion du monde implique obligatoirement une nécessité d’où les notions de destin et de providence chez les stoïciens. A l’opposite, l’absence d’intervention divine pose les bases d’une causalité purement mécanique. Sur ce point, Epicure a été extrêmement clair : « Il sait (le sage) que les évènements viennent les uns de la fortune (la chance), les autres de nous, car la fatalité (le destin) est irresponsable et la fortune est inconstante ; que ce qui vient de nous n’est soumis à aucune tyrannie, et sujet au blâme et à l’éloge. Il vaudrait mieux en effet suivre les récits mythologiques sur les dieux que devenir esclaves de la fatalité des physiciens. La mythologie laisse l’espérance qu’en honorant les dieux on se les conciliera, mais la fatalité est inexorable, (Diogène Laërce, ibid. p. 262, 263). » La condamnation est sans appel : le destin et la providence sont des notions à ce point nocives qu’il vaut encore mieux revenir à Homère ou à Hésiode plutôt que les adopter. L’évocation des atomes d’Epicure (notamment chez Marc-Aurèle) dans les textes stoïciens illustre également l’opposition entre les deux écoles. « Rappelle-toi le dilemme, recommande Marc-Aurèle : ou une providence ou des atomes. (...) Sur la mort : C’est une dispersion, s’il n’y a que des atomes. Mais, s’il y a retour à l’unité, c’est une extinction ou une émigration. (...) Ou bien, il n’y a que des atomes et rien autre que confusion et dispersion. (ibid. IV, III. VII, XXXII. IX, XXXIX). » D’évidence, les atomes, avec leur légère déclinaison, sont incompatibles avec une doctrine prônant un monde régit par la seule nécessité.
Ces divergences majeures ne pouvaient qu’être lourdes de conséquences sur le plan éthique. Alors que, tout en vivant en accord avec la nature, celle d’Epicure proposait à l’homme d’écouter et de suivre ses sensations, Zénon préconisa de se soumettre aux évènement et donc, de les accepter. C’est ainsi que l’épicurisme devint un sensualisme et un hédonisme alors que le stoïcisme s’orienta vers un naturalisme, certes matérialiste, mais totalement immergé dans une théologie maîtresse de la nécessité. Dès lors, les recommandations d’Epictète deviennent compréhensibles : « Ne demande pas, nous dit-il, que ce qui arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. (...) Ne dis jamais de quoi que ce soit : « Je l’ai perdu. » Mais : « Je l’ai rendu. » Ton enfant est mort, il est rendu. Ta femme est morte, elle est rendue. (Manuel VIII et XI.) » Un peu plus loin, dans le même texte (XXXIII), il ajoute : « Et si, après cela, ton devoir est d’y aller (à un rendez-vous difficile), vas-y et supporte ce qui doit arriver, et ne dis jamais en toi-même : « Ce n’était pas la peine. » Cette réflexion est d’un homme vulgaire, et qui se récrie contre les choses extérieures. » Plus tard, Marc-Aurèle accordera aussi son consentement à l’ordre naturo-divin : « Tout me convient de ce qui te convient, ô monde ! Rien pour moins n’est prématuré ni tardif, de ce qui pour toi de temps opportun. Tout est fruit pour moi de ce que produisent tes saisons, ô nature ! Tout vient de toi, tout réside en toi, tout retourne en toi. Pensées pour moi-même, (ibid. IV. XXIII.) » Ainsi donc, pensa Marc-Aurèle : « Rien ne vient de rien et tout ce qui naît provient d’une transformation. » Peu étonnant, dès lors, qu’il n’ait pas hésité pas à évoquer le fragment 76 d’Héraclite : « La mort de la terre est de devenir eau, la mort de l’eau est de devenir air, et la mort de l’air, de se changer en feu, et inversement.( ibid. IV. XLVI. » Fille de l’une des notions essentielles de la pensée antique, « l’éternel retour » (ou palingénésie), cette conception héraclitéenne du changement cyclique irrigue le texte de Marc-Aurèle : « Médite fréquemment la rapidité avec laquelle passent et se dissipent les êtres et les évènements. La substance est, en effet, comme un fleuve en perpétuel écoulement. (...) Tous les objets qui tombent sous les yeux bien vite se transforment : ou bien ils se dissiperont comme un encens brûlé, si la substance est une ; ou bien ils se disperseront. (...) Sans cesse entre les choses, les unes se hâtent, les autres se hâtent d’avoir été. (ibid. V, XXIII. V, IV. VI, XV.) » Par conséquent, tout disparaît pour réapparaître. La vie se confond avec le seul présent et la mort n’est que la suppression de ce présent : « C’est du seul présent, en effet, nous dit Marc-Aurèle, que l’on peut être privé, puisque c’est le seul présent qu’on a et qu’on ne peut perdre ce qu’on n’à point (ici, Marc-Aurèle évoque le passé et l’avenir) (ibid. II, XIV.) » Si donc, la mort consiste à perdre le présent, cette perte s’inscrit également dans une problématique beaucoup plus générale : « La perte de la vie, précise Marc-Aurèle, n’est pas autre chose qu’une transformation. Tel est ce qui plaît à la nature universelle, et c’est selon ses plans que tout se fait à propos, que tout, depuis l’éternité, semblablement se produit et se reproduira sous d’autres formes semblables à l’infini.( ibid. IX, XXXV.) »
S’il a bien existé une école philosophique pour laquelle « philosopher, c’est apprendre à mourir.(Montaigne, Essais 1, 20.) », c’est bien celle que fondèrent les stoïciens. En effet, que nous disent-ils ? Il faut nous soumettre à une nature qui décide de tout ce qui nous arrive, y compris, la mort au sujet de laquelle, d’ailleurs, il est préférable de ne point porter de jugement et se souvenir, nous conseille Sénèque, : « Qu’elle vient vers nous : elle serait à craindre si elle pouvait rester avec nous : nécessairement ou elle n’arrive pas ou elle passe. (Lettre à Lucilius No 4.) » Il faut donc, nous disent-ils encore, uniquement se préoccuper des choses qui dépendent de nous et, surtout, supporter ce qui doit arriver. Le bonheur des stoïciens repose manifestement sur l’acceptation et le renoncement. Il ne faut point craindre la mort ; il faut se défier des jugements qui troublent les hommes. De la sorte : « Nul ne pourra nous léser, remarque Epictète, (...) car on ne peut être lésé que si l’on juge qu’on nous lèse. (Ibid. p. 196.) » En d’autres termes, on ne peut être malheureux si l’on juge que l’on ne l’est pas. Nous pouvons noter dès à présent le pouvoir démesuré que les stoïciens prêtèrent à la raison. En effet, si l’on veut bien les suivre, il suffit de décider que l’on est heureux pour l’être en veillant, bien entendu, à réunir les conditions nécessaires à ce bonheur. Seulement, les désirs, et les plaisirs qu’ils préfigurent, existent et, les uns et les autres, sont particulièrement tenaces et envahissants. Cela, les stoïciens ne pouvaient l’ignorer. C’est pourquoi (comme, de son coté, le prescrivit Epicure), il faut les limiter le plus possible afin de ne pas en dépendre. « Quant une idée de plaisir se présente à ton esprit, nous fait savoir Epictète, garde-toi, comme pour les autres idées, de ne te point laisser par elle emporter. (...) Compare ensuite les deux moments : celui où tu joueras du plaisir, et celui où, tu te repentiras et tu te blâmeras.( ibid. p. 201.) » Quelques décennies auparavant, Sénèque avait déjà recommandé la plus grande des prudences : « Ton pauvre corps également, même si rien ne peut se faire sans lui, crois qu’il est une chose plus nécessaire que grande ; il fournit des plaisirs vains, courts, suivis de remords et, s’ils ne sont pas dosés avec une grande modération, voués à passer à l’état contraire. (ibid. p. 135.) » Concernant Marc-Aurèle, il aurait été des plus surprenant qu’il aille à l’encontre de ces avis : « Quant à celui qui poursuit les plaisirs, il ne pourra pas s’abstenir des plaisirs, et cela est aussi une impiété manifeste.( ibid. IX, I) »
Pour les stoïciens, la paix de l’âme (l’ataraxie) résulte donc d’une sorte d’ascèse privilégiant la raison au détriment du corps. Les stoïciens pensent, nous dit Diogène Laërce : « qu’il y a trois bonnes affections : la joie, la prudence, la volonté ; la joie est le contraire du plaisir, car elle est un désir raisonné ; la prudence est le contraire de la crainte, car elle est une fuite raisonnée (...) Enfin la volonté est le contraire du désir, en ce qu’elle est un souhait raisonné.(ibid. p. 89.) » Si le corps ne peut être totalement nié, dématérialisé, en quelque sorte, il est considéré comme le générateur potentiel de troubles pouvant affecter l’âme. C’est pourquoi la raison doit s’employer à enrayer ses velléités en le détournant de désirs considérés comme inutiles et perturbateurs. C’est sans doute ce constat désespérant que dénonce Michel Onfray : « (...) Tant et si bien que leur dolorisme (celui des stoïciens) entre en symbiose (avec la doctrine chrétienne) et constitue la religion de la pulsion de mort que l’on sait. (ibid. p. 188.) » Et, de fait, il suffit de lire Marc-Aurèle pour débusquer au fil des pages cette pulsion de mort qui relève de l’obsessionnel.
Si, par hypothèse, l’ataraxie des stoïciens est une forme de bonheur, il s’agit là d’un bonheur négatif puisqu’il repose sur l’amputation délibérée des exigences naturelles du corps. En effet, il est condamné au déni de lui-même et doit s’effacer devant une raison obsédée par son accord avec une nature dont on peut se demander qu’elle pourrait être son utilité dans de telles conditions. Si la vie n’est qu’un renoncement, si elle ne consiste qu’à “supporter et s’abstenir”, si elle n’est que l’attente de la mort, à quoi bon vivre ? « Entraîne-toi à la mort, conseille Sénèque, qui dit cela ordonne de s’entraîner à la liberté. (...) Il n’y a qu’une seule chaîne qui nous tient ligoté, l’amour de la vie. (ibid. Lettre No 26.) »
“Il ne faut donc pas aimer la vie”, vient de nous dire Sénèque. Quel aveu ! Mais, ceci étant, ne pas aimer la vie ne revient-il pas à ne pas aimer la nature ? Or, précisément, la nature n’est-elle pas la vie elle-même ? D’autre part, est-il si sage de “s’entraîner à la mort” comme si celle-ci devait être le point de mire d’une finalité quelque part désirée ? Nous sommes ici quasiment dans l’idéologie chrétienne selon laquelle la vie sur terre n’est qu’une étape préparant le fameux “salut céleste”. Certes, il n’existe aucune transcendance chez les stoïciens donc, pour eux, la mort n’est pas le début du voyage de l’âme vers un problématique au-delà. Toutefois, elle demeure la cause finale de la vie. Et, même si cela est vrai, n’est-il pas désespérant d’en faire la préoccupation majeure de sa pensée ?
L’une des conditions du bonheur des stoïciens est donc « d’accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu. (...) Et surtout, d’attendre la mort avec une âme sereine sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Marc-Aurèle, (ibid. II, XVII.) » En outre, il faut se défier des quatre passions négatives relevées par Hécaton : La douleur, la crainte, le désir et les plaisirs. Pourquoi cette liste ? Diogène Laërce nous répond : « La douleur est une contraction irraisonnée de l’âme. Elle a pour espèces : l’apitoiement, l’envie, l’émulation la jalousie, l’angoisse, le trouble, le chagrin, l’affliction et la confusion. (...) La crainte est une attente du mal. Elle comprend la peur, l’hésitation, la honte, la terreur, le saisissement et l’anxiété. (...) Le désir est un souhait irraisonné, à quoi sont subordonnées les affections suivantes : indigence, haine, rivalité, colère, amour, ressentiment et emportement. (...) Le plaisir est un désir irraisonné d’une chose qui paraît souhaitable. Il comprend : le charme, la joie du mal, la jouissance et le relâchement. (ibid. p. 88, 89.) » Que l’absence de douleur et de crainte soit considérée comme l’une des conditions du bonheur, peut très facilement se comprendre. Mais, intégrer à cette absence le désir et le plaisir peut difficilement se concevoir dans la mesure ou tous deux constituent la dynamique essentielle de la vie. En effet, que pourrait devenir un corps privé de jouissance ? Et, de surcroît, quel avenir pour une âme enfermée dans un tel corps ? Voici à quel excès conduit une conception du bonheur ne reposant que sur une absence de troubles et sur la soumission à un destin accoré d’une providence.
Si donc l’ataraxie des stoïciens est un état acquis grâce à l’évitement de tout élément perturbateur, le bonheur peut-il exister ? Oui, ont-ils répondu. Pour comprendre leur raisonnement, il faut revenir au précepte de Zénon : « La fin est de vivre conformément à la nature, c’est à dire à la vertu, car la nature nous conduit à la vertu. (Diogène Laërce, ibid. p. 80.) » Ce fragment nous explique qu’il suffit de vivre conformément à la nature (ce qui implique de la bien connaître, rappelons le) pour parvenir à la vertu. Une remarque s’impose : dans la mesure ou la vie conforme à la nature résulte d’une connaissance, la vertu à laquelle elle conduit relève également d’une connaissance. Ce constat est lourd de conséquences dans la mesure ou il induit que les conduites humaines relèvent d’un savoir. Or, si cela était vrai, le divorce entre le corps et la raison serait effectivement rédhibitoire et le bonheur ne pourrait dépendre que de la seule raison. C’est la voie, semble-t-il, qu’ont emprunté les stoïciens et l’on peut dès lors se demander, comme le fit Nietzsche au sujet de Socrate, si considérer la vertu comme un savoir est une faute. Si l’on cantonne la vertu dans le cadre des “bonnes” conduites et le bonheur dans celui de l’accomplissement global des potentialités humaines, le corps ne peut être dénié. Par contre, si l’on considère la vertu comme condition sine qua non du bonheur on assujettit ce dernier aux dictats de la raison. Pourquoi pas ? Pourrait-on penser puisque la raison, précisément, constitue l’essentiel de la grandeur humaine. Certes, mais en est-on véritablement assurés ? La sagesse, la première des quatre vertus cardinales, ne constitue-t-elle pas un objectif inaccessible ? Finalement, n’est-elle pas une utopie ce qui en induirait une autre : celle d’une ataraxie assimilée au bonheur ? Je ne sais pas si ce doute a effleuré l’esprit des stoïciens mais on peut le supposer lorsque l’on écoute Sénèque : « Nulle sagesse, en effet, n’élimine les défauts naturels du corps et l’âme : tout ce qui est ancré et congénital est atténué par l’exercice sans être vaincu.(ibid. p. 68. ) » Bref, est-il possible de “voir un véritable stoïcien” comme le demanda Sénèque ? Mais, question plus cruciale encore : à quoi sert la philosophie ? Marc-Aurèle répond : « Qu’est-ce donc qui peut nous guider ? Une seule et unique chose : la philosophie. Et la philosophie consiste en ceci : à veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans dommage, et soit au-dessus des plaisirs et des peines. (...) Et, en outre, à accepter ce qui arrive et ce qui lui est dévolu, comme venant de là d’où lui-même est venu. Et surtout, à attendre la mort avec une âme sereine... (ibid. II, XVII.) »
Cette réflexion a pour inconvénient de confondre sagesse et philosophie. Cette dernière est un “savoir penser” alors que la sagesse, si elle relève également d’un savoir, est un “savoir vivre”. Ceci étant, l’une et l’autre sont liées car, comme nous le dit Montaigne : « La philosophie nous instruit à vivre. » Rarement, le rôle essentiel de la philosophie a été aussi clairement défini. Si nous devons philosopher c’est parce que, quelque part, nous ne savons pas vivre et c’est pourquoi il nous est aussi difficile d’atteindre le bonheur. « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard, disait Aragon. » Combien cela est vrai et combien Epicure eut raison d’affirmer : « Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher... (Lettre à Ménécée, p. 258.) » Si donc, l’ataraxie est une forme de bonheur, celle des stoïciens ne peut prétendre véritablement l’être dans la mesure ou ce qu’elle propose est un bonheur passif, un bonheur « en repos », un bonheur acquis grâce à un “refoulement” des désirs car ceux-ci pourraient troubler notre âme. Si l’on voulait pousser cette doctrine jusqu’aux portes de l’absurde, on pourrait penser que cette ataraxie et la mort ne font qu’une car seule la mort nous garantit une totale absence de troubles. Peut-on véritablement se contenter de ne rien ressentir pour être heureux ? Finalement, à quoi bon penser si c’est pour vivre si peu ? Suffit-il de respecter à la lettre les prescriptions du décalogue (les dix commandements) pour accéder au bonheur ? Qui pourrait affirmer cela ? C’est ici que s’établit la différence entre l’éthique et la morale. L’éthique tente de nous apprendre à bien vivre alors que la morale se contente de nous dire comment bien agir ou, en d’autres termes, quels sont nos devoirs, qu’ils soient envers nous-mêmes ou envers les autres. Que nous ayons des devoirs, c’est l’évidence même mais que nous n’ayons que des devoirs est une absurdité. Et, c’est tout à fait le cas en ce qui concerne la morale dite “Judéo-chrétienne”. Que nous prescrit-elle, en effet ? Tu ne feras pas ceci et encore moins cela sinon, prends garde à la colère de dieu. Qu’elle sinécure ! D’une manière moins brutale, les stoïciens disent à peu près la même chose : tu ne jouiras pas trop, pas du tout serait encore mieux, sinon prends garde à la colère de ton âme ! Finalement les stoïciens ont surestimé la raison et, surtout, le pouvoir de la volonté. Ils ont oublié que l’homme a un cœur qui « a ses raisons que la raison ignore » et c’est cette fragilité qui fait sa beauté et sa grandeur.
Ceci étant, les stoïciens se sont bien rendu compte que leur idéal de sagesse n’était, au final, qu’un idéal uniquement réalisable par le sage. Mais, en furent-ils aussi certains ? Il suffit de lire un fragment de la lettre No 2 de Sénèque pour en douter : « Nulle sagesse, en effet, n’élimine les défauts naturels du corps et de l’âme : tout ce qui est ancré et congénital est atténué par l’exercice sans être vaincu. » La sagesse ne serait donc qu’un outil tout au plus capable d’atténuer les errements du corps et de l’âme. Et, l’ataraxie, serait, en quelque sorte, une récompense attribuée aux hommes ayant su utiliser cet outil. Mais alors, à quoi peut servir une éthique dont la finalité apparaît être inaccessible ? Ici encore, le réalisme des stoïciens les a conduit à distinguer ce qui était possible de ce qui ne l’était pas. C’est ainsi, qu’ayant considéré la sagesse (et le bonheur “ataraxique” qui la couronne) comme une utopie (un peu comme la cité idéale de Platon), ils ont énoncé un certain nombre de préceptes dédiés à la vie ordinaire. Cette parénétique (que l’on peut traduire par : conseils ou recommandations) se distingua par son accessibilité ce qui permit à la morale stoïcienne de s’humaniser.
Nous devons cependant remarquer que la division de l’éthique stoïcienne (ou de la morale, selon certains penseurs) en une éthique pouvant être qualifiée de “théorique” et l’autre, de “pratique”, pose un problème au niveau de l’ataraxie : celle-ci peut-elle être acquise par l’une ou par les deux ? Et, en filigrane, peut-on acquérir le bonheur en se bornant à respecter les préceptes de la morale pratique ? En d’autres termes, l’acte de volonté par lequel on s’efforce de bien se conduire, tant vis à vis de soi-même que vis à vis des autres, suffit-il pour être heureux ? Et, au-delà, l’une de ces deux morales “rit-elle de l’autre ? » Si l’on considère que seule la morale théorique conduit à l’ataraxie, on condamne cette dernière à l’inexistence puisque, du propre aveu des stoïciens, la sagesse n’est que de peu d’utilité en matière de perfection. A l’opposite, si l’on admet que la morale pratique est susceptible d’aboutir à cette même ataraxie, on se heurte à une redoutable aporie (contradiction insoluble). En effet, l’âme peut-elle vivre sans troubles lorsqu’elle connaît l’existence d’un état de quasi-béatitude qui lui est interdit ?
Il appert donc que le bonheur et l’ataraxie, et bien qu’ils soient liés, demeurent malgré tout deux choses différentes. Et, de même que le bonheur n’est rien sans le plaisir (et qu’elle que soit la forme de ce dernier), le bonheur n’est rien non plus sans l’ataraxie. Les stoïciens nous disent (à juste titre) que l’on ne peut être véritablement heureux dans la peine, la souffrance, le trouble mais, ils n’ont pas forcément raison d’en exclure le plaisir qui est le moteur de la vie. L’ascétisme des stoïciens a ceci de désespérant qu’il repose uniquement sur la mortification du corps et sur les privations qui lui sont infligées. Dans ce sens, la philosophie stoïcienne est entachée d’une certaine forme de morbidité et d’un masochisme, somme toute, assez malsain. Loin d’apporter la liberté, leur panthéisme est une prison dans laquelle les détenus sont maltraités par eux-mêmes. Philosophes du déchirement, les stoïciens n’ont peut être pas compris que l’homme n’est pas uniquement le savant quasi éthéré que voudrait être leur sage mais qu’il est également ignorance et fragilité. En tant que conscience de lui-même, l’homme est un esquif dont l’errance solitaire le rapproche chaque jour davantage d’un port oh ! Combien redouté ! Bien qu’elle soit le fleuron de son être, il n’a pas grand chose à espérer de sa raison dès lors qu’il lui assigne la régence de la totalité de sa vie. Le corps de l’homme est le centre de ses désirs, son esprit est l’initiateur de ses pensées. S’il veut comprendre, non pas les mathématiques ou la géométrie, mais le sens de son existence, il doit philosopher. Non, parce que « son âme est malade », comme l’écrivit Sénèque avec son optimisme habituel, mais parce que la philosophie est le seul astre qui puisse éclairer sa raison et apporter une justification aux battements de son cœur.
Patrick Perrin


